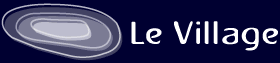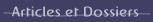Rions (encore) avec Nicolas
Par Sullivan Le Postec.
Vendredi 21 octobre, à l’occasion des rencontres cinématographiques de l’ARP, Nonce Paolini et Nicolas de Tavernost, les dirigeants de TF1 et de M6, ainsi que Rodolphe Belmer, numéro 2 de Canal+, étaient réunis à Dijon.
Vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble, trois grand patrons de l’audiovisuel français ensemble ? Eh bien, c’est simple : il suffit de faire venir à vous l’image d’une cour de récréation d’école primaire. Vous vous rappelez comment les cancres, gros bras et Q.I. d’amibe, s’en prenaient à la poignée d’élèves un peu solitaires mais studieux, qui faisaient des efforts pour s’en sortir plutôt que de se satisfaire de la médiocrité ? A la télé, c’est pareil. Le seul acteur qui, avec ses limites et ses défauts, développe une vision réaliste de l’avenir du secteur et essaye de faire preuve d’ambition, bref le seul décidé à travailler au moins un peu, se fait très souvent coincer dans un coin et taper dessus par les molosses rendus teigneux par leur justifié complexe d’infériorité.
Après que Belmer ait répété le discours de bon sens tenu par Canal + depuis un an, sur la nécessité pour les chaînes françaises de s’armer de contenus forts pour parer à la concurrence prochaine de la télé connectée et d’acteurs tels que Google TV et Hulu, Nicolas de Tavernost s’est senti de dénoncer : ‘‘C’est un merveilleux roman qui vient de nous être conté’’. Une semaine plus tard, le même annonçait pourtant que le budget programme de M6 allait nettement augmenter en 2012. On a le sentiment que si Belmer avait annoncé avant que 2+2 font 4, de Tavernost se serait dressé dans son canapé pour affirmer, la main sur le cœur, qu’en fait ça fait douze.
Après ça, le patron de M6 s’est aussi plaint que Canal+ refuse de revendre les droits en clair de ses séries. Parce que pour Nicolas, le summum de la création, ce serait de racheter « H » (il a vraiment cité cette série, je jure que je n’invente pas !), maintenant qu’il a mis la main sur « Un Gars Une Fille ». M6, c’est vraiment la télé du moindre effort et du risque zéro. Pourquoi développer des fictions quand ça demande du travail, une vraie vision du public et que ça reste une expérience risquée dans laquelle les échecs sont plus nombreux que les succès ? Autant racheter direct les vieilleries sur lesquelles les concurrents ont sué sang et eau il y a dix ans ! Le pire étant qu’en France, où l’on confond les cyniques et les malins, ça marche.

- Nonce Paolini, Rodolphe Belmer, Rémi Pfilmlin et Nicolas de Tavernost
- Photos : 21èmes Rencontres Cinématographiques de L’ARP - Julien Attard
Nonce Paolini s’est exprimé ensuite. Lui aussi s’y connaît en mauvaise foi, mais contrairement à l’idiot de la classe, il n’est pas prêt à s’humilier totalement en public. Paolini a au moins le mérite de taper là où ça fait un peu mal : le dirigeant de TF1 a mis en cause la politique de racolage actif de Canal, où le sexe est devenu le premier argument de vente de la Création Originale. Évoquant une reprise sur le clair de « Borgia », il a déclaré : ‘‘s’il s’agit, pour la diffuser, d’ôter les séquences qui en font le charme, vous risquez de vous apercevoir que les fesses des nonnes intéressent plus que la vie du Pape’’.
Évidemment, tout le monde aura constaté qu’à part tenter d’empêcher Canal+ de développer ses projets, les patrons de TF1 et M6 n’ont mis aucune véritable proposition sur la table. Bref : le PAF va mal, et ce n’est pas prêt de s’arranger.
Au pays des scénaristes libres
Par Dominique Montay.
It’s the Nerdist writer’s panel on the Nerdist podcast channel / Ben Blacker talking writing with writers / Writers talking writing can get pretty exciting / The talk can be enlightening / It’s really very frightening / Ben Blacker talking writing with writers
De mémoire.
Je suis obsédé (c’est la faute du chef, qui m’a fait découvrir le podcast) par cette émission d’une heure trente environ, disponible dans toutes les bonnes podcasteries, depuis à peu près deux mois. C’est quoi me demanderez vous ? Ben Blacker, scénariste sur « The Thrilling Adventure Hour », une dramatique radiophonique et sur « Supernatural », invite plusieurs scénaristes, et ils parlent d’écriture. That’s it (et c’était dans la chanson qui m’a servi d’introduction, donc c’était facile à deviner).
Et c’est juste passionnant. Et drôle. Et terrifiant. Et ça peut rendre dépressif. Ou pas. Enfin… Quoi qu’il en soit, c’est génial.
Les invités sont juste énormes : Meredith Stiehm (« Cold Case »), Dan Harmon (« Community »), Damon Lindelof (« Nash Bridges »… et « Lost ») ,Tim Minear (« Angel », « Firefly », « Terriers »), Jane Espenson (« Buffy », « Angel »…), Peter Tolan (« Larry Sanders Show », « Resue Me »), David Fury (« Buffy », « 24 »)… Bon, je vais arrêter ou cet article va ressembler à un annuaire.
C’est passionnant car on y apprend énormément, en quelques podcasts sur la façon dont on obtient du travail aux États-Unis, sur comment fonctionne une Salle d’écriture, sur la différence entre les Dramas et les Comédies (en dehors de leur ton et leur durée, évidemment), sur la différence entre le câble et les grandes chaînes nationales…
C’est drôle, parce que les scénaristes sont des personnages. Certains sont juste hilarants. Dan Harmon, quand il explique avoir tout fait dans le mauvais sens sur la première saison de « Community », en ne refaisant que peu écrire ses autres scénaristes et en reprenant tout lui-même. David Fury quand il explique la façon de bosser sur « 24 » : “Un type arrive en disant "Tiens, et si Jack enlevait le pape ?", et on lui répondait, "Super, va écrire ça"”. Damon Lindelof qui met en parallèle sa peur panique d’être en charge d’une série comme « Lost » : “J’ai commencé par écrire un personnage qui devient le chef mais qui n’a pas du tout envie de l’être”. Ou Peter Tolan qui fait voler en éclat les égos des scénaristes : “Ce n’est pas un art, c’est un business”... et celui des comédiens “donner la possibilité d’écrire à un acteur, c’est confier une arme automatique à un bébé”…
C’est terrifiant. Car leurs expériences parlent de doute, de craintes, de pages blanches, de rapports conflictuels, de manque de sommeil, d’absence de vie sociale, de ruptures de contrats, de séries qui s’achèvent, de procédurals qui vous rincent…
Ça peut rendre dépressif dans deux cas. Déjà, parce que si on est auteur, on a envie d’être à leur place. Ensuite parce qu’il ne faut pas perdre de vue que c’est un programme américain, qui parle de la condition du scénariste aux États-Unis. Et qu’en France, on est juste à des années-lumières de ça. Sans sacraliser le statut de scénariste aux USA, on ne peut malgré tout que les envier. Ils ont des syndicats puissants, capables de geler l’industrie. Ils ont des cursus scolaires clairs et ils existent depuis des décennies. Qu’on ne se méprenne pas, ça doit être aussi difficile là-bas qu’ici de réussir dans le milieu, mais soyons francs, leur système, aussi bancal soit-il, a le mérite d’être 1000 fois plus rationnel que chez nous. Parce que la normalité, là bas, c’est la salle d’écriture.
Un endroit où vous pouvez commencer comme grouillot. Le type qui fait des recherches, qui apporte les cafés, qui prend les notes, qui s’apparente à un esclave mais qui, occasionnellement aura la possibilité de prouver sa capacité de travail, ou même pitcher des idées. Et au bout d’un moment, on finira pas lui confier de plus en plus de travail… pour enfin, au bout de quelques années, si son talent le lui a permit, s’il a apprit suffisamment, se retrouver à gérer sa propre série. Une progression qui tient du rêve, et qui ne concerne pas tout le monde dans le business, mais qui a le mérite d’exister.
En France, vous pouvez débarquer de quasi-nulle part et vous retrouver à gérer votre série. Si c’est un coup de boost à votre carrière, et même si c’est amplement mérité, ce n’est en aucun cas un cadeau. C’est aussi ce qui pousse les décideurs à ne pas faire confiance aux auteurs, à les encadrer, à les laisser de côté au moment du tournage. Un réflexe qui s’étend du débutant au scénariste confirmé, et qui passe du principe de précaution à une façon de travailler généralisée.
Par son aspect rationnel, et industrialisé à l’extrême, qui semble de l’extérieur sclérosant et sur-encadré, les américains ont en fait créé le système le plus épanouissant possible pour les scénaristes. Un système qui fait peur et tellement envie à la fois.
Ce système est décortiqué, exprimé d’une façon ultra-ludique par les meilleurs spécialistes américains, avec une liberté de ton absolument incroyable (pour illustrer, ce qu’un scénariste français vous dit en chuchotant en vous faisant promettre de ne pas le répéter, eux le disent bien fort dans un micro, devant public, en sachant que ça sera diffusé sur Internet et écouté par des milliers de personnes, plus par les gens de la profession) dans le podcast de Ben Blacker.
Alors si je n’ai qu’un conseil à vous donner, regardez « Luther »… pardon, réflexe… donc, si j’ai deux conseils à vous donner, regardez « Luther », et puis après (ou avant, je vais pas vous dire comment vivre votre vie à ce point, quand même), écoutez Nerdist Writer’s Panel [1].
La part de rêve
Par Émilie Flament.
Quelle est la différence entre les histoires que nos parents nous lisaient avant de dormir lorsqu’on était enfant et les fictions que nous regardons une fois devenu adulte ? Aucune, a priori, à part le niveau de violence et de sexualité (surtout si vous regardez les séries Canal +). Il y en a pourtant une : le merveilleux.
Si les contes de notre enfance en étaient remplis, la plupart des fictions ‘‘adultes’’ en sont dépourvues. Les exceptions, séries fantastiques ou de science-fiction, sont souvent dénigrées par les critiques et une partie du public pour leur manque de réalisme. Pourtant, cet élément essentiel a bercé notre enfance, alors pourquoi devrait-il disparaître parce que nous vieillissons ? Pourquoi la maturité exclurait-elle forcément le merveilleux ?
Ces mythes, contes et légendes ont une véritable fonction sociologique. Ils sont à la fois l’expression de l’inconscient humain et les fondements de nos valeurs. Qu’ils s’appuient ou non sur des faits historiques ou réels, il ne leur est pas nécessaire d’être vraisemblable pour porter leur message, leur leçon de vie. Bien au contraire, ce détachement leur permet de mettre en avant des éléments nécessaires à toute personne : la force des idéaux et l’espoir.
Certes, le monde n’est pas rose, la vie est dure et les happy ends ne sont pas fréquents. Mais justement. Soit vous avez perdu tout espoir, et je vous conseille de regarder « Braquo », histoire de continuer à broyer du noir ; soit vous avez envie de croire encore en l’avenir de l’être humain, et je vous invite à revoir les dernières saisons de « Doctor Who » par exemple.
En cette période où le mot ‘‘crise’’ est sans doute le plus prononcé, le merveilleux est plus que bienvenu, quelqu’en soit la forme. Les américains ne s’y sont pas trompés et c’est avec deux séries inspirées par ce thème qu’ils ont préparé leurs grilles de rentrée, « Once Upon A Time » et « Grimm ». Pas besoin forcément de tomber dans le conte de fées pour insuffler une touche d’épique ou de mythique à une histoire, après tout le merveilleux est en quelque sorte le miroir de l’homme. Qu’on se base sur des récits fondateurs à la façon de « Kaamelott » ou qu’on saupoudre des éléments fantastiques, l’important est de mettre en avant la force des idéaux.
Au final, sur tous les plans, petits et grands ont besoin des mêmes choses pour vivre, physiquement et moralement. C’est pourquoi cette part de positivisme, je dirai même de foi en l’homme, me semble nécessaire à tous. Grandir ne veut pas dire arrêter de rêver. La maturité aide juste à prendre du recul et à faire la part des choses. Alors pourquoi nos histoires d’adultes devraient forcément sombrer dans le réalisme (voire même le pessimisme) et perdre ce qui nous a fait aimer les histoires ? Le merveilleux.
Sarko et « Borgia » : la victoire culturelle de Canal+
Par Sullivan Le Postec.
Jeudi soir, en direct à la fois sur TF1 et sur France 2, le Président Sarkozy évoquait à la télévision la crise économique en Europe, avec la volonté de faire preuve de pédagogie. Et là, au milieu de la conversation, s’est glissée une référence à une série française. Du jamais vu.
‘‘Il s’est passé un phénomène depuis 30 ans : les grands pays émergents, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud, le Mexique, ont des populations à nourrir, et il est bien normal qu’ils veuillent leur part du progrès’’ a expliqué le Président de la République.
‘‘Quand vous regardez la série récente, les Borgia, on voit que le concert des nations du monde au XVIe siècle, c’était quatre, cinq pays : ça se discutait entre l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Aujourd’hui nous sommes au XXIe siècle et [les pays émergents] veulent leur part du progrès.’’
Vidéo : PureMédias.
Dans les années récentes, on a parlé de Laura Bush qui avait décrit en 2005 sa vie à la Maison Blanche comme celle d’une desperate housewife dans une tentative d’humour dont on pourra discuter du bon goût : ‘‘Je suis mariée au Président des États-Unis, et voici notre soirée type : 21h, Monsieur Excitation dort à poing fermés, et je regarde « Desperate Housewives » — avec [la femme du Vice-Président] Lynne Cheney. Mesdames et messieurs, je suis une femme au foyer désespérée. Si ces femmes dans cette série pensent qu’elles sont désespérées, il faudrait qu’elles soient avec George’’.
On se souvient aussi de la passion d’Obama, admise pendant la campagne, pour « The Wire » en général et le personnage d’Omar en particulier.
En France, difficile de trouver des allusions publiques équivalentes, même si le Président Sarkozy avait déjà fait part à des journalistes, mais en privé, de sa fascination pour « The West Wing ». C’est encore moins le cas si on parle de séries françaises — on peut comprendre qu’il ne se soit trouvé aucun homme politique pour faire référence à « Navarro ».
L’allusion de Nicolas Sarkozy à « Borgia » dans un cadre très solennel illustre la victoire culturelle de Canal+ en matière de fiction. Et quelques soient les limites de sa politique éditoriale et les reproches légitimes qu’on peut adresser à la chaîne cryptée, c’est là quelque chose d’essentiel qu’on ne peut pas lui enlever.
Depuis plus de vingt ans, la fiction française a, au mieux, été associée à un plaisir coupable. Mais plus généralement, elle a en fait incarnée la médiocrité voire le ridicule. La communication arrogante de Canal+ est parfois très irritante, surtout pour nous qui sommes proches du sujet et constatons l’écart entre la promesse émise par le « Créateur Original » de « Créations Originales » et la réalité. Reste que la série française à tout à gagner à être perçue comme cool plutôt que comme la dernière des ringardises. Cela lui donne au moins une chance d’être regardée...
Dernière mise à jour
le 14 novembre 2011 à 22h39
Articles par le Village
Dans la même rubrique
Notes
[1] Bon, faut un niveau correct en anglais, quand même