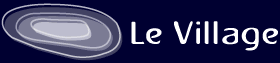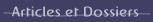L’adaptation « en local », parfois très fidèle aux originaux, de fictions achetées à l’étranger est une nouvelle tendance lourde du marché audiovisuel mondial. Rares auparavant, elles se limitaient en général à des achats de concepts largement recyclés. Mais, depuis peu, de véritables adaptations « copier-coller » fleurissent un peu partout (« Betty la fea », « The Office », « Desperate Housewives » en Amérique Latine...) On pourra déplorer la défaite de l’imagination et la mondialisation façon marché de la création. Mais, de notre point de vue franco-français, on doit peut-être aussi réaliser que ces projets pourraient représenter une opportunité à saisir...
C’est en juillet 2005 que TF1 annonça avec force tambours et trompettes avoir acheté le droit de décliner en France « New York : Section Criminelle » (« Law & Order : Criminal Intent »). Dans les faits, TF1 paye 130 000 $ par épisode pour le droit d’adapter les scénarios et l’univers de la série originale, ainsi que pour les conseils de Dick Wolf, créateur de la franchise, et de Leslie Jones, directrice du département d’export de formats de NBC Universal. Déjà, l’année dernière, la même chaîne avait acheté le droit de localiser « RIS », une série Italienne créée pour surfer sur la vague des « Experts », et qui lui coûta très vraisemblablement beaucoup moins cher. Il convient de noter, d’ailleurs, qu’après deux saisons presque exclusivement composées de traductions-adaptations de scénarios de la série italienne, la troisième, en préparation actuellement, tournera, elle, autour de scénarios originaux. Par ailleurs, on a aussi vu Canal + adapter à la lettre la première saison de « The Office » en un « Bureau » local. Là aussi, on nous annonce qu’après ce galop d’essai, la série va s’émanciper de son modèle. Cette manière de faire n’est pas sans rappeler celle des américains eux-mêmes en matière de remake de séries étrangères, ce dont ils sont coutumiers en ce qui concerne les séries anglaises. (Voilà qui, au passage, enterre l’idée selon laquelle ces remake seraient obligatoirement la mort de l’Art ; comme en toute chose, il s’agit de savoir comment et en quelles proportions ils sont faits.)
On connaît le peu de confiance mutuelle qui s’est installé entre les diffuseurs et les créatifs de la fiction française. Ces productions en sont l’une des traductions : lorsqu’une chaîne veut innover un peu dans la formule de ses productions maison, puisqu’elle pense « ses » auteurs (comprendre ceux avec lesquels elle est habituée à travailler ; comprendre aussi qu’il leur semble visiblement hors de propos d’envisager d’aller en chercher d’autres) incapables de le faire, elle va faire ainsi ses emplettes dans les Marchés télé, confie les reines de l’adaptation à des auteurs dont elle se dit qu’ils vont ainsi apprendre leur métier et devraient être en mesure de produire du réellement inédit le jour venu. C’est donc l’innovation sans risque, qu’importe combien les deux termes soient antinomiques, que cherchent les diffuseurs concernés. Avec ces adaptations fidèles de format dont on connaît la qualité, la possibilité de se planter tant qualitativement qu’à l’audimat est limitée.
On ne manquera pas, tout de même, se soulever l’hypocrisie totale des propos de TF1 qui, par la voix de Takis Candilis, déclara au Wall Street Journal le mois dernier que : « il est vrai que la plupart des scénaristes et réalisateurs [français] ne savent pas travailler sur un format court. Ceux qui savent mettent trop longtemps ». Candilis expliquait ensuite que développer une série originale française moderne en 52 minutes aurait mis des années, sans garantie de succès. Or, prise de court par le virage qualitatif et le succès de la fiction de France Télévision (juillet 2005 c’est juste quelques mois après le succès de « Clara Sheller »...) amorcé dès 1998 avec par exemple « PJ » ou « Avocats & Associés », TF1 avait alors pour impératif de dégainer très vite sa nouvelle fiction.
Pour autant, on aimerait aimablement faire remarquer à Candilis que si les créatifs français ont perdu l’usage des formats courts, c’est bien sous la pression du TF1 privatisé et de sa politique de standardisation de la fiction initiée en 1987. Ils existaient auparavant. Par ailleurs, s’il s’agit de former des auteurs à ces nouvelles approches, peu de structures françaises peuvent se prévaloir autant que TF1 d’avoir la possibilité matérielle de le faire. C’est bien de leur part une question de volonté, pas de moyens.
En outre, le manque de rapidité des scénaristes français est peut-être aussi à rechercher dans la précarité dans laquelle ils sont entretenus par notre mode de développement sous-payé et aléatoire, qui les oblige à courrir plusieurs lièvres à la fois. De la même manière, TF1 est encore et toujours celle qui aurait le plus les moyens de remédier à ça...
Pour en revenir à notre sujet, l’ironie, bien sûr, est aussi que l’accord signé en juillet 2005 dans l’objectif d’une mise en chantier rapide n’aura débouché sur la diffusion de « Paris : Enquêtes Criminelles » [1] que quasiment deux ans plus tard. Ce temps de développement, anormalement long quand on sait qu’il ne s’agit tout de même que de traduire-adapter en français 8 épisodes de la première saison de « L&O :CI », a une explication. Et elle est passionnante. C’est ce même article du Wall Street Journal qui nous en livre les clefs.
Ce papier remet en perspective l’intérêt stratégique de ce projet du point de vue américain. Leur constat est le suivant : le marché de l’export de leur propres productions a probablement atteint son sommet. Au mieux, il peut stagner. Au pire, développement des moyens financiers des diffuseurs dans le monde et sophistication du public aidant, il risque de diminuer au profit des productions locales.
Dès lors, le marché de la vente de « licence de reproduction » de série est vu comme un nouveau débouché qu’il est nécessaire de développer afin de maintenir les recettes. Le projet de TF1 est l’un des premiers au monde qui se fasse avec un pays à hauts moyens capables de produire en masse de la fiction haut de gamme. D’autres pays en Europe en attendent les résultats avant de savoir si le jeu en chandelle, c’est-à-dire si la réussite est à la hauteur de l’investissement.
En effet : une question demeure : les américains n’ont pas vu, sauf exceptions, les séries anglaises que leur télévision reproduit. Les Européens, eux, ont massivement vu les séries américaines qu’on nous propose d’adapter. Le spectateur de TF1 aura-t-il une objection à regarder d’autres versions de scénarios qu’il a déjà vu mis en images dans « New York : Section Criminelle » ? La question se pose, mais la réponse se devine : si on additionne le fait que le public de la fiction française et celui des séries américaines ne se recoupent que (très ?) partiellement, au fait que « NYSC » n’a pas été diffusée en prime-time, mais plutôt en seconde partie de soirée, il y a fort à parier que peu de gens se rendront compte de quelque chose le jour de la diffusion.
Toujours est-il que le succès de « Paris : Enquêtes Criminelles » est donc apparu crucial aux américains. Dès lors, ils ont mis tous les atouts de leur coté pour l’atteindre, y compris en allant là où TF1 et les producteurs (Alma Productions) ne les attendaient pas : c’est-à-dire en allant jusqu’à s’impliquer au quotidien dans la production de la série. L’article du Wall Street Journal est un récit du point de vue américain des saillantes différences culturelles entre les parties, et de la sidération, exprimée de façon aussi politiquement correcte que possible, mais quand même, de Dick Wolf et Leslie Jones, la conseillère de NBC, face aux méthodes françaises de production d’une série télévisée.
On se rend bien vite compte que Wolf a senti qu’il allait falloir y mettre les grands moyens. La Bible transmise aux français fait ainsi pas moins de 1000 pages. Non, ce n’est pas une erreur de frappe ! Entre autres, elle contient ainsi la recette complète pour fabriquer du faux sang, sans parler de la pleine page de contrat qui explique où, quand et comment utiliser le « ca-ching », le son caractéristique des séries de la galaxie « Law & Order ».
L’article laisse entendre que de nombreuses et animées négociations ont eu lieu en coulisse, et que ce sont bien elles qui ont considrablement ralenti la production. Par exemple, TF1 voulait initialement un acteur beaucoup plus âgé pour le rôle principal (Roger Hanin ou Pierre Mondy style, ces magnifiques flics octogénaires so frenchy) avant de capituler pour Vincent Pérez, susceptible d’apporter à la série son aura cinématographique. A un autre moment, TF1 insistait pour engager un acteur au physique agréable pour un rôle secondaire dans un épisode, Wolf insistant pour expliquer que la laideur du personnage était partie intégrante de l’histoire, et obtenant finalement gain de cause. Même argumentations au sujet du décors principal de la série : le bureau des filcs, ou encore de la technique pour porter une arme à feu, genre de détails effectivement insignifiants à la télévision française qui se contrefout usuellment du réalisme.
Le récit d’une bataille perdue par la production américaine se situe sur un autre niveau : si Dick Wolf sera crédité comme créateur de la série, il ne le sera pas comme producteur exécutif. En effet, ce crédit aura fait basculer la série du statut de production française à celui de production internationale, et elle ne serait plus entrée dans les quotas de diffusion d’œuvres françaises, lui interdisant du même coup probablement l’accès au prime-time sauf à réduire la dose d’Experts qui y officient. Ce fut, nous explique-t-on, la « négociation du siècle ».
Il est d’ailleurs bien possible que l’obligation de faire capituler Wolf sur ce point (la législation étant ce qu’elle est) a d’autant plus, ensuite, renforcé la nécessité pour TF1 de céder du terrain et de donner à Wolf du lest (beaucoup, comparé au reste des productions de la chaîne) dans le domaine créatif. En terme de résultats, de deux choses l’une : soit ces négociations ont tiraillé la série dans tout les sens au point qu’il n’en ressorte plus rien, ou bien les américains auront réussi à tirer le résultat vers le haut et « Paris : Enquêtes Criminelles » pourrait trancher très agréablement avec le reste des séries de la première chaîne.
Et enclencher un cercle vertueux ?
Verdict dans quelques semaines à la diffusion de la série.
Post Scriptum
L’article du Wall Street Journal — absolument passionant ! — peut-être lu ici sur Lawandorder-fr.com, la référence française sur les séries de la franchise.
Dernière mise à jour
le 17 février 2011 à 00h46
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
- DOCTOR WHO — An Unearthly Child (épisodes 1 à 4, 1963)
Dans la même rubrique
Notes
[1] Créateur & Consultant artistique : Dick Wolf ;
Direction littéraire : Franck Ollivier ;
Réalisation : Gilles Beat (épisodes 1 à4), Bertrand Van Effenterre (épisodes 5 à 8) ;
Avec Vincent Pérez et Sandrine Rigaux.