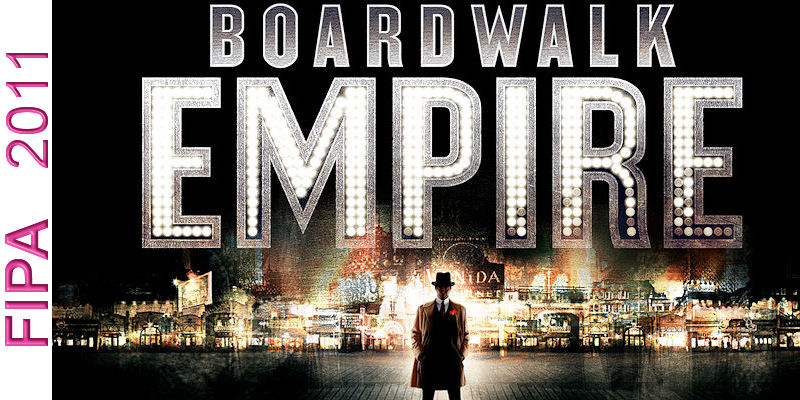La rédaction du Village est toute la semaine au FIPA. Sullivan Le Postec, Emilie Flament ainsi que Carine Wittman, la rédactrice en chef d’AnnuSéries, vous racontent le Festival au jour le jour.
Le périple
Le Sud, c’est cool. Mais c’est loin, quand même. Franchement l’idéal, ce serait que le Sud soit beaucoup près de Paris. Voire carrément à Paris. Dans l’attente de la réalisation de ce fantasme que le réchauffement climatique pourrait bien transformer un jour en réalité, Biarritz reste à cinq heures et quelques de train de Paris. Ce qui est sans doute très supportable.
Un peu moins en cas de grèves des employés de la Compagnie des Wagon-lits, qui signifie fermeture du bar sur tout le trajet, et impossibilité de s’acheter la moindre boisson dans un TGV ou quelque vil sbire, dans sa perversion, aura pris soin de pousser le chauffage à fond. Heureusement que le collègue Manu de Spin-off est monté à bord en gare de Bordeaux muni de ravitaillement.
Nous avons profité de ce trajet pour enregistrer une discussion qui sera quotidienne, et qui se centre donc en ce premier jour sur nos attentes et sur les événements que nous attendons le plus.
Arrivée en gare de Biarritz, il nous reste encore à réussir la partie course d’orientation du festival : débarqués dans une ville qui nous est totalement inconnue, notre mission est de réussir à trouver où se trouve notre hôtel, et surtout comment on y va. Faut qu’on vous l’avoue : l’orientation n’est surement pas la plus affûtée de nos qualités. On n’est pas des cas désespérés non plus : contrairement à un certain estimé collègue travaillant pour un gros site dont le nom commence par « Allo » et se termine par « ciné », nous ne positionnons pas Strasbourg au Nord. Grâce à cela, nous mènerons notre mission à bien.
Ouverture
La cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour la déléguée générale, Teresa Cavina, de présenter les six jurys qui auront à charge de juger les œuvres présentées au FIPA. Oui, six jurys. Le premier est celui du Prix Michel Mitrani, doté par France Télés, qui récompense une première, deuxième ou troisième réalisation européenne. Les cinq autres jurys correspondent aux cinq catégories de programmes audiovisuels présentés au FIPA : ‘‘Musique et spectacle’’, ‘‘Grands reportages et faits de société’’, ‘‘Documentaires de créations et essais’’, et les eux catégories qui nous intéressent plus particulièrement au Village : ‘‘Fictions’’ (qui regroupe les téléfilms unitaires) et ‘‘séries et feuilletons’’.
Le jury de la catégorie Fiction se compose de MarionHänsel (Réalisatrice / Belgique), sa Présidente et de Fabrice Cazeneuve (Réalisateur / France), Michel Demopoulos (Responsable des programmes / Grèce), Maruschka Detmers (Comédienne / Pays-Bas), Masamichi Sawada (Productrice / Japon).
Le jury de la catégorie Séries et feuilletons, lui, regroupe Alexandra Stewart (Comédienne / Canada) sa Présidente, ainsi que Simon Brook (Réalisateur / Royaume‐Uni), Joan Dupont (Journaliste / Etats‐Unis), Samuel Labarthe (Comédien / France), Saara Saarela (Réalisatrice / Finlande).
Après ses Présentations, le Président du Fipa Olivier Mille a partagé ses remerciements, avant que le Maire de Biarritz ne déclare officiellement ouverte cette 24e édition. Teresa Cavina a alors entamé la présentation de la projection d’ouverture, le pilote de la série « Boardwalk Empire », de Terence Winter. Malheureusement, les membres du public risquent de ne pas ressortir de cette soirée en sachant que Winter est le showrunner et l’âme créative de cette série, le nom de Martin Sorcese, producteur de la série et réalisateur du Pilote, ayant pris toute la place. De quoi confirmer l’impression un peu désagréable, parfois, que le FIPA est un festival de programmes de télévisions qui se place, dans un esprit très français, dans une position de domination culturelle complète du cinéma. Il y a comme une petite musique qui se dégage, entre louanges de cinéastes et sélection faisant la part belle à des œuvres qui n’ont pas l’air d’être très sûres de savoir si elles appartiennent au cinéma ou à la télévision.
La télé doit-elle faire son cinéma ?
C’est indéniable. Il y a désormais une convergence entre le cinéma et la télévision. Les frontières se brouillent. C’est indéniable mais cela ne doit pas non plus être surestimé. Le cinéma et la télévision restent deux expériences complètement différentes.
Dans le premier cas, vous choisissez un programme, vous effectuez l’acte fort qui consiste à sortir de chez vous, vous participer à une expérience collective partagée avec des inconnus, vous êtes captifs et sans autre distractions pendant la durée de la projection, et vous bénéficiez de conditions de visionnage optimales.
Dans le second, vous avez constamment le choix entre une multitude de programmes qui se battent pour votre attention. Vous avez constamment le choix d’en changer. L’expérience de visionnage est intime, ou au moins familiale, et la vie ne s’arrête pas : votre téléphone peut sonner, le voisin sonner à la porte, vous pouvez aller chercher à manger ou aux toilettes, et rares sont les gens à faire alors le choix de mettre le programme en pause, même dans le cas où ils possèdent un système de contrôle du direct.
Cette question de la frontière entre la télévision et le cinéma me rappelle une expérience de Russell T Davies qu’il relate dans « The Writer’s Tale ». A l’occasion d’une avant-première, il assiste à une projection de l’épisode spécial de Noël de « Doctor Who » « Voyage of the Damned » sur grand écran. Et, pour lui, fin connaisseur du média télévision (pas étonnant que son sa supervision, « Doctor Who » soit devenue la série N°1 en Grande-Bretagne), c’est là une expérience très pénible.
Le montage, conçu pour la télévision, semble soudain hytérico-épileptique. Le mixage sonore, pensé pour le petit écran, est réduit à une caricature ou les sons son sur-découpés. Et la réalisation, qui privilégie les gros plans, ne passe pas. Bref, cet épisode n’est tout simplement pas à sa place sur cet écran géant. Russell T Davies comprend parfaitement trop bien ce que beaucoup essaient d’oublier – voire dans certains cas, ce qu’ils ne sont pas assez compétents pour percevoir.
C’est la limite de la convergence actuelle du cinéma et de la télévision que d’en venir à produire des œuvres bâtardes, qui ne sont ni l’unes ni l’autres. Prenez « Carlos » la mini-série de Canal+ par Assayas. Le téléspectateur a le choix entre le montage long, celle que le réalisateur considère comme la vraie version, mais qu’il doit voir sur un petit écran de télévision alors que les plans ont été pensés pour le grand, et le montage court, projeté au cinéma mais qui ne rend pas justice à la vision de l’auteur.
Qui aura vu « Carlos » dans des conditions optimales, c’est-à-dire dans sa version longue mais sur grand écran de cinéma ? Une poignée quasi négligeable d’happy few.
De là à dire que la convergence cinéma et télévision, ce sont des œuvres pour riches, de la création audiovisuelle hyper-élitiste et snob, il n’y a qu’un pas. Que je vais franchir parce qu’entre vous et moi, c’est ce que je pense.
Boardwalk Empire
Alors, la série a-t-elle fait sauter mes préjugés exposés hier ? Non. Et elle a renforcé ma conviction personnelle sur la chimère de la série cinématographie, exposée plus haut.
Quarante minutes d’exposition pas très enlevée en ouverture, ça peut passer en introduction d’un long film de cinéma de trois heures, quand on le voit captif et concentré dans un cinéma. Mais au démarrage d’un pilote à qui il ne reste alors plus que très peu de temps, malgré sa durée exceptionnellement longue de 70mn, pour raconter une histoire, c’est une très mauvaise idée. Si on n’est pas un téléspectateur très averti et acquis, qui reviendra la semaine suivante uniquement du fait de la promesse HBO / Scorcese, cette introduction ne donne tout simplement pas envie de voir la suite. Parce qu’il est difficile de passer outre le fait que ces 70mn ne racontent pas grand-chose.
Pour autant, il y a quelques scènes très réussies (celle de l’introduction d’Al Capone, évidemment), et le personnage de Michael Pitt se dégage et pique méchamment la curiosité (ce qui compense le traitement caricatural et forcé du personnage pricnipal).
Tentant de donner l’impression de raconter un minimum quelque chose qui se tienne, le Pilote échoue par contre avec l’intrigue pleine de misérabilisme, de pathos et de caricature de la femme enceinte battue qui perd son bébé. Comme la scène finale concerne cet axe, on a d’autant moins envie de se précipiter pour voir la suite.
Plus d’une série HBO a mis un certain temps avant de se trouver réellement. Je ne peux pas encore juger de la qualité de la série « Boardwalk Empire ». Juste dire qu’en ce qui concerne ce Pilote, c’est beau, bien joué, bien produit, mais aussi ennuyeux et au bout du compte assez médiocre.
A lire : la critique parfaite de ce pilote par Perdusa.
Demandez le programme !
Au programme ce mardi 25 janvier :
L’événement : Projection des épisodes 1 & 2 (sur 8) de la série de France 2 "Les Beaux Mecs". (20h)
Mais aussi : "C’era una volta la citta dei Matti". Mini-série italienne (Il était une fois la cité des fous). (15h30)
Unitaires : "Kongo" / Allemagne (18h15) ; "Majka Asfalta" / Croatie (16h) ; "Petite Fille" / France (20h30)
Dernière mise à jour
le 25 janvier 2011 à 15h42
24e FIPA (Edition 2011)
- JOURNAL D’UN TYPE QUI NE VA PAS A BIARRITZ - 1x01
- Le Village au FIPA
- FIPA CI, FIPA ÇA — Introduction (lundi 24 janvier)
- BISTRO FIPA — 30 janvier : des prix et des moutons
- FIPA CI, FIPA CA — La télé doit-elle faire son cinéma ? (mardi 25 janvier)
- FOCUS — Les Beaux Mecs
- JOURNAL D’UN TYPE QUI NE VA PAS A BIARRITZ - 1x02
- MAJKA ASFALTA — Mère Asphalte
- FIPA CI, FIPA ÇA — Cette fois c’est parti ! (mercredi 26 janvier)
- VITE VU — Au 24e FIPA
- FIPA CI, FIPA ÇA — Xanadu day (jeudi 27 janvier)
- JOURNAL D’UN TYPE QUI NE VA PAS A BIARRITZ - 1x03
- FIPA CI, FIPA ÇA – Un drame anglais... (vendredi 28 janvier)
- AVANT-PREMIERE — Xanadu, épisodes 1, 2 & 3
- DEBAT - La Télévision Connectée : la création de demain sera-t-elle connectée ?
- AVANT-PREMIERE — Borgen, épisodes 1 & 2
- FIPA 2011 — Le Palmarès fiction et séries
- RENCONTRE — Death in Paradise : dans les coulisses d’une co-production BBC / France Télé
- WEB-SERIE - Addicts
- REPORTAGE — Une semaine au FIPA
- ENTRETIEN — A la découverte de BBC Worldwide
- RENCONTRE — Fiction britannique : un focus et ses ratés
- FRANCIS HOPKINSON — ‘‘La télévision britannique a développé un esprit plus commercial’’
- SIMON WINSTONE — “Nous voyons la télé comme les français voient le cinéma”
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français