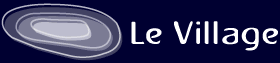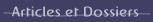Quelques mois après « David Nolande », France 2 se lance à nouveau sur les terres du fantastique par l’intermédiaire de « Greco » [1] qu’elle diffuse pour la première fois en mai 2007. Mais il n’est plus question ici de la case du mercredi soir, mais bien de celle du vendredi, la fameuse ‘‘Soirée de polars’’ installée il y a dix ans de ça. La série est donc plus franchement policière. Mais donc, aussi, plus directement formatée.
Article originellement publié le 31 mai 2007.
Excès de cases
Il y a quelques semaines, France Télévision présentait lors d’une conférence de presse l’organisation de son offre de fiction à compter de la prochaine saison. Celle-ci repose sur une régularité des rendez-vous, mais aussi sur une série d’étiquettes. Pour France 2, ce sera ainsi « Histoires » le mardi (mieux appréhender le monde dans lequel on vit pour faire de la chaîne un lieu de mémoire), « Mouvements » le mercredi (la société d’aujourd’hui avec ses inquiétudes et ses espoirs vus de multiples point de vue), et « Crimes » le vendredi (un univers policier proche de la série noire dans lequel on pose la question du bien et du mal). France 3, quant à elle, se voudra « Romanesque » le jeudi et se consacrera au « Suspense » le samedi.
L’intention de proposer des rendez-vous fixes au public afin de le fidéliser est louable, à défaut de me convaincre parfaitement (un vrai rendez-vous fixe, ce serait surtout de bonnes séries françaises installées sur des semaines grâce à de longues saisons de vingt épisodes). Mais le problème le plus important de ce type de labels, si appliqués d’une façon trop rigide, c’est de prendre le risque de « raboter » des projets innovants pour faire entrer des ronds dans des cases bien carrées — et de se retrouver avec des monstres difformes à l’heure de la diffusion. Ironiquement, ce piège béant que nous pressentions s’est vu confirmé à peine quelques semaines plus tard lors de la diffusion de « Greco ». La série d’investigations paranormales qui existe en potentiel se voyant ramenée à une ‘‘série policière à fantômes’’ trop terne pour être mémorable : le fantastique est trop en arrière plan pour marquer — ou être original — mais il prend pourtant trop de place pour que les enquêtes policières puissent être développées au point de devenir vraiment intéressantes. Ou alors, il faudrait que la série gagne sérieusement en rythme.
En quête de paix
Le Capitaine Mathias Grecowski, dit Greco (P. Bas), est une tête brûlée, un risque-tout dont l’attrait pour le métier de flic semble moins reposer sur la volonté de maintenir l’ordre que sur son addiction à la poussée d’adrénaline. Il exaspère sa partenaire, la toute jeune (24 ans) Lieutenant Danica Miller (A. Lunati). Celle-ci, prenant acte d’une incompatibilité devenue assumée, a d’ailleurs demandé à leur supérieur hiérarchique, le Commissaire Vanderwalk (M. Leroux) de changer d’affectation.
C’est alors que, au cours d’une mission, Greco est grièvement blessé par balle en sauvant une fillette. A son réveil après trois semaines de coma, ses cheveux sont devenus grisonnants (clin d’oeil à la série « MillenniuM » de Chris Carter, source d’inspiration originelle de Philippe Setbon dans la définition d’un personnage principal passablement dépressif et au bord du ’’pétage de plomb’’). Surtout, il est hanté par les souvenirs de son expérience de mort rapprochée : le tunnel, la lumière blanche, et au bout, six silhouettes. Six morts qu’il a ramenés avec lui. Six morts qui attendent quelque chose de lui pour trouver la paix. Sur la base de portraits-robots de ses apparitions, réalisés par la spécialiste Arleth Shenge (M. Gabin), Greco s’entête à rouvrir des enquêtes depuis longtemps abandonnées. C’est que l’homme a profondément changé. Plus humble, plus généreux, plus cérébral, aussi. Ses rapports avec Danica, qui construisent désormais rapidement une amitié indéfectible, en témoignent.
Vanderwalk observe ce manège — et surtout ces incroyables résolutions d’affaires — avec incrédulité mais aussi fascination. Secrètement, Vanderwalk partage avec ses deux enquêteurs une blessure similaire. Il est sans nouvelle de son fils, parti explorer l’Himalaya 8 ans plus tôt. Danica a vécu son enfance et son adolescence dans la douleur d’avoir perdu un père, disparu du jour au lendemain sans laisser de traces — et en emportant le chien. Quand à Greco, sa femme Catherine l’a quitté deux ans plus tôt. Lui aussi semble toujours figé dans l’attente d’un coup de téléphone, ou même d’un simple signe de vie, qui semble ne jamais vouloir venir. Il n’a jamais quitté l’appartement où il vivait avec Catherine. Parce que si elle devait revenir, il veut qu’elle sache où le trouver.
Sans rien dire de ses arrières pensées personnelles, le Commissaire Vanderwalk obtient la création d’une brigade expérimentale, nommée ’’Greco’’, localisée dans un bureau en sous-sol. Greco et Miller y sont libres de mener leurs investigations.
Les six silhouettes
Dans le premier épisode, « Contact » c’est un pédophile disparu deux ans plus tôt, une semaine après sa sortie de prison, qui hante Grecowski. Intéressant démarrage, puisque Greco et Miller travaillent donc à aider un criminel des plus odieux à trouver la paix, d’autant que leur enquête apportera la preuve de sa culpabilité, jusque là seulement circonstancielle. Pourquoi alors continuer ? Parce que ces enquêtes aident aussi d’autres personnes à trouver la paix, qu’ils attendent des nouvelles du disparu ou craignent son retour, comme les parents d’une victime du fantôme de ce premier épisode. Du fait de leur propre blessure, les personnages sont parfaitement à même de comprendre cela, et donc de poursuivre ces enquêtes jusqu’au bout.
« La deuxième silhouette » est celle d’une jeune femme morte en même temps que son enfant, qu’elle ne touche ni ne regarde pourtant jamais quand ils apparaissent à Greco. L’enquête dévoilera le secret de cette affaire de meurtre qui dissimule un échange de bébé après la mort accidentelle de celui de la voisine de chambre de la victime à la maternité. Les enquêtes de ces deux épisodes partagent des défauts similaires : elles sont extrêmement prévisibles, au point d’être parfois, comme dans le second épisode, à la limite du manque de respect pour l’intelligence du public qui regarde. Ainsi, le temps et la débauche de moyen (une séquence de rêve) déployée pour alerter sur le fait qu’un personnage a utilisé le prénom complet de la victime, comme le meurtrier, alors que tout le monde l’appelait de son diminutif, est à la limite du ridicule.
« Corps et âme » bénéficie d’une enquête bien meilleure, même si la manière dont il dépeint le monde du porno n’est pas sans clichés. Les défauts sont pour partie toujours présents ; mais ils ont aussi ’’l’avantage’’ d’être transparents et instructifs. Le premier bon point de l’épisode est en effet qu’il est déjà bien entamé au moment où l’enquête commence pour de bon. Auparavant, tandis que l’on se penche donc plus sur les personnages, leurs rapports et leurs passés, on observe une vraie progression par rapport aux deux premiers épisodes. Et si le mystère de la mort de l’ex-chanteuse devenue actrice de porno qui hante Greco se laisse moins facilement résoudre, on se retrouve, de peur qu’on ne comprenne pas bien, avec une ahurissante séquence d’explication finale qui ne fait QUE répéter des informations déjà apportées précédemment à divers moments de l’épisode, appuyant encore cette manie française de prendre l’audience par la main et de lui faire des schémas pour tout bien lui expliquer. Cela a beau être fait d’une manière qui réussi à être visuellement jolie, ça reste quelque chose qui n’aurait jamais du sortir de la salle de montage — en admettant que ça n’ait pas déjà été coupé du scénario au fil d’une ré-écriture menée avec un peu de bon sens.
On l’a dit, le souci apporté aux personnages de la série et à leur développement participe du succès relatif de cet épisode. Le trio de base réussi à devenir petit à petit extrêmement attachant, en dépit de lourdeurs assez gênantes, parfois. Comme la scène ou Greco débite un monologue théâtral à une photo de sa femme (même si là aussi c’est joliment mis en scène et d’ailleurs très bien joué). Comme lors de ces quelques séquences artificielles dans lesquels des éléments construisant la psychologie des personnages sont amenés à la massue. En témoigne dans « Corps et âme » la petite séquence dans la voiture, avant le dénouement, où Danica ’’devine’’ que Greco n’a pas d’arme sur lui, qui est tout sauf naturelle et d’autant plus horripilante que cela aurait été dramatiquement cent fois plus fort que Danica — et nous — découvrions cet absence d’arme au moment même du face à face avec le méchant de l’épisode. La scène de confrontation entre les deux partenaires qui aurait suivi, et qui en serait devenue beaucoup plus dramatique et plus tendue, aurait ensuite avantageusement remplacé la séquence "cet épisode de « Greco » pour les nuls" qui vient trouver sa place à ce moment.
« La fille de quelqu’un » achève de placer le curseur du coté des personnages puisque cette fois-ci, le fantôme qui vient demander à Greco de lui apporter la paix n’est pas un inconnu. Il s’agit du propre père du Lieutenant Danica Miller. Cet homme qui a disparu quand elle avait 8 ans, en emportant avec lui le bébé labrador qu’il venait de lui offrir. Entretenant bien sûr le plus longtemps possible le mystère sur les conditions de la mort de Joseph Miller, l’épisode construit en fait une véritable réhabilitation du personnage, dont on découvre qu’il est mort accidentellement alors même qu’il faisait tout pour offrir la meilleure vie possible à sa famille. Concernant le développement des personnages, cet épisode est aussi celui de la rencontre entre Ilda Floss (F. Rahouadj), la psy de Greco, et le commissaire Vanderwalk. Une heureuse combinaison qui offrira à la série de très bons moments. Si cet épisode n’est pas tout à fait à la hauteur de ses enjeux, son intrigue lui permet toutefois d’être l’un des plus mémorable de cette première saison. On s’étonnera peut-être d’ailleurs que la saison ne se soit pas conclu pas lui plutôt que par une intrigue plus classique. C’était dans l’absolu un choix courageux qui aura évité à la série d’être prévisible. Il aurait cependant paru plus légitime si l’intrigue du sixième épisode s’était révélée moins poussive.
C’est en effet un défaut commun aux deux derniers épisodes de la première saison, « Mon Assassin » et « Petite Julie » que d’offrir des enquêtes intéressantes, mais dont la construction est laborieuse. Il s’agit à nouveau de vieilles affaires qu’il faut rouvrir. La première concerne une vieille veuve, dont la Brigade Greco se demande ce qu’elle peut lui vouloir : elle n’est pas portée disparue mais bien officiellement décédée, et sa meurtrière, sa propre soeur, est en prison. Bref, l’affaire n’offre aucune véritable prise, et c’est seulement parce que Greco découvre qu’en cas d’inaction, ses fantômes sont capables d’une certaine agressivité — qui rouvre sa cicatrice — qu’il s’obstine à tenter d’en trouver une. Les investigations s’avèrent plus riche en rebondissements que la moyenne de la série, notamment parce que le jeu de la vraie coupable avec les enquêteurs, c’est à dire ne pas se cacher mais assumer au contraires ses possibles mobiles, fonctionne aussi sur le téléspectateur qui n’en fait pas automatiquement sa seule suspecte (surtout que, pour une fois, Greco, lui, la soupçonne immédiatement). La difficulté de l’enquête et l’insistance du fantôme d’Ines entraînent leur part de conséquences inattendues, puisque la vieille veuve s’invite encore plus que jamais auparavant chez Greco, allant jusqu’à passer toute une soirée assise à ses cotés. Ce qui ne le met pas particulièrement à l’aise. Malheureusement, l’épisode est passablement terni par sa résolution. Alors que Greco et Danica ont compris les tenants et les aboutissants de l’affaire, mais qu’ils ne peuvent rien prouver, tous les protagonistes de l’affaire se retrouvent, par le plus grand des hasards, nez à nez dans le hall du bureau de police. Le mari cocu se saisit donc d’une arme, tue la coupable (dont on a appris qu’elle avait la même psy que Greco, ce qui vient s’ajouter aux autres coïncidences tout en étant parfaitement inutile) et on supposera que cela suffit à pousser la complice aux aveux, puisque la soeur innocente qui voulait protéger son fils est libérée de prison.
Dans « Petite Julie », le problème est encore plus épineux puisque l’affaire de la mort de cette enfant est prescrite depuis dix ans, et que le coupable était lui-même trop jeune au moment des faits pour risquer quoi que ce soit de toute façon.
Mais plutôt que de tenter une résolution symbolique, qui pourrait très bien suffire à la victime pour trouver la paix, le scénario s’acharne à aboutir à une conclusion dramatique, ce qui conduit la encore à la mort du coupable au terme d’une scène qui flirte aux limites du grand-guignol (c’est la seule fois de la série, ce qui est exceptionnel pour une série fantastique française, et c’est dès lors d’autant plus dommage que cela soit pour le dernier épisode). On ajoutera que les éléments mis en place par l’épisode auraient sans trop de difficulté pu permettre de mettre en place une telle fin symbolique, qui aurait pu consister à inverser le parcours de vie des protagonistes. Nous avions en effet découvert que les deux enfants qui connaissaient la culpabilité du troisième sans l’avoir jamais révélée ont porté toute leur vie le lourd poids de leur conscience et sont comme abîmés par ce fardeau. Le coupable, lui, semble sincère quand il dit avoir oublié les événements et vit sa vie de Golden Boy sans remords. Inverser ces trajectoires après la révélation de la vérité aurait constitué une fin sans doutes moins concrète, mais finalement plus satisfaisante que celle-ci qui semble vouloir dire qu’un homme mérite de mourir pour une erreur commise à l’âge de 10 ans.
Un désir de fantastique
Il faut l’avouer : la vraie conclusion de ce sixième épisode et de cette saison, celle que l’on retiendra, n’est pas celle-ci. Il s’agira en effet de cette nouvelle visite par Greco du fameux tunnel que quitte la petite Julie... pour mieux le laisser envahir par une foule de nouvelles silhouettes dont on sait évidemment les intentions vis à vis de lui. Une foule qui lui est présentée par une silhouette reconnaissable : celle de sa femme Catherine. Une vision qui fait de ce rêve un cauchemar. A cet instant, on découvre sans doute mieux qu’avant dans la série notre attachement réel au personnage de Greco. Un attachement qui met la puce à l’oreille : malgré les limites et lourdeurs des intrigues individuelles, beaucoup évoquées jusqu’ici, il semble bien qu’au moins à certains nivaux, la série soit parvenue à fonctionner, à nous toucher, à créer un lien empathique entre nous et ses personnages.
La première réussite de la série est d’autant plus remarquable qu’elle est rarissime en France : c’est celle de sa mise en image, de son ambiance, de sa musique originale, et plus globalement des séquences fantastiques. Philippe Setbon a trouvé dans cet univers une bouffée d’oxygène qui a motivé son désir de revenir à la réalisation. On sent cette envie dans la qualité de ces scènes, le soin qu’il y a mis, mais aussi leur bon goût. Qu’il soit à vocation onirique (les scènes de rêve se situant dans le tunnel où Greco rencontre les silhouettes) ou horrifique (les ’’attaques’’ des fantômes pour provoquer l’action de Greco), ce fantastique sait en effet toujours où s’arrêter avant de courir le risque du ridicule — un gouffre au bord duquel « David Nolande », par exemple, s’approchait dangereusement. Le travail visuel sur la lumière, les filtres et traitements de l’image est particulièrement soigné et efficace. Ces scènes sont aussi rehaussées par la musique originale de Erwann Kermorvant, qui installe parfaitement l’ambiance au travers de sa partition violonneuse. On saluera au passage l’utilisation judicieuse du son pour véhiculer du sens à plusieurs reprises, par exemple pour nous faire ’’partager’’ les migraines aiguës de Grecowski. Dommage, d’ailleurs, compte-tenu de cette qualité musicale, que le générique n’en fasse pas meilleur usage — une fois encore, ce sont des explications qui auront été privilégiés...
Plus généralement, devant cette réussite, on regrettera évidemment que la tonalité de la série soit beaucoup plus policière que réellement fantastique. Ce qui nous ramène au début de cet article. Ce qui, aussi, nous rend beaucoup plus stimulante la perspective d’une seconde saison qui plongerait plus avant dans cet aspect. On croise donc les doigts pour que le formatage dû à la case soit moins appuyé en seconde année.
Des personnages riches
Ce que « Greco » parvient aussi très bien à faire, c’est à construire au fil de ces six épisodes des personnages riches et chez qui on perçoit déjà des évolutions dans un temps assez court. Si cette caractérisation est parfois amenée de manière lourde (on l’a vu plus haut avec l’exemple de l’arme que Greco ne porte souvent plus), cela n’empêche pas qu’au fil des épisodes, le fait que Philippe Setbon ait réussi à construire des personnages qu’il connaît visiblement très bien finit par transparaître et concourir pleinement à l’affection qu’on ressent pour eux. Ils sont riches de détails, importants comme futiles, et d’un background travaillé.
Greco lui-même doit beaucoup à Philippe Bas. Il porte le personnage avec beaucoup de charisme et de magnétisme, et son jeu s’avère toujours parfaitement juste. Surtout, on se rend compte au fil des six épisodes des subtilités qu’il y a mis. Ainsi, le caractère dépressif de Greco dans les tous premiers épisodes n’est pas forcément saillant (sans doute, aussi, parce que la comparaison avec « David Nolande », qui forçait cet aspect jusqu’à la caricature, est inévitable). Mais elle apparaît rétrospectivement avec plus de force quand on a l’occasion de voir Greco s’ouvrir, d’une meilleure humeur, ce qu’illustre le port d’un pull bleu alors qu’il a été temporairement abandonné par ses visions et qu’on ne l’a pratiquement vu qu’en noir depuis son réveil. Greco est aussi devenu un hyper-sensible, comme le symbolise, à un niveau plus terre à terre, son rejet des odeurs de cigarette ou de café, mais aussi sa nouvelle précision quand il se sert à nouveau de son arme (peut-être une piste de développement lors d’épisodes futurs...). Pour autant, Greco n’a pas forcément envie que cela se sache, et travaille sur lui, en tout état de cause, pour la maîtriser. Une énergie paradoxale que Philippe Bas incarne à merveille, notamment par le truchement de son jeu corporel.
Il est évident qu’Audrey Lunatti, dans le rôle de Danica Miller, ne fait pas pareille impression. Pourtant, on se prend à apprécier beaucoup plus le personnage à la fin de la saison qu’au début. J’y vois surtout le résultat de la qualité d’écriture globale des personnages, que je viens d’évoquer. Et puis, disons, une certaine habitude face à jeu qui manque souvent de naturel de l’actrice, particulièrement dans son phrasé sur-articulé.
Le duo de flic masculin-féminin est forcément confronté à l’idée d’un potentiel romantique. La série s’en sort plutôt bien. Quand elle commence, Greco et Danica ont des relations exécrables, transformées par le coma de la tête brûlée que Danica ne supportait plus, mais qui a disparu à son réveil. Greco a changé, et cet homme nouveau et les enquêtes qu’ils mènent ensemble, qui réveillent la cicatrice de la disparition de son père, fait qu’ils se rapprochent. Vanderwalk est le premier à le deviner. Mais il perçoit aussi toute la complexité de ce rapport : si Danica ressent une affection pour Greco, celle-ci est tout autant amoureuse que maternelle, et il est parfois difficile de faire la part des choses, pour elle comme pour ceux qui l’entourent. Greco, en outre, tend à la circonscrire dans ce rôle de mère, qui ne la met pas forcément très à l’aise, de part l’amour éperdu qu’il porte encore à Catherine (autre clin d’oeil à « MillenniuM », puisque c’était aussi le prénom de la femme de Frank Black) bien qu’elle ait disparu sans laisser de traces depuis deux ans.
Le commissaire Vanderwalk est un autre cas complexe. Tel qu’il est joyeusement surjoué par Maxime Leroux, il divisera sans doute entre ceux qu’il amusera et ceux qu’il horripilera. C’est une tentative intéressante, en tout état de cause, d’investir autant de caractéristiques comiques dans un personnage tel que celui du « supérieur hiérarchique qui aime bien ses ouailles mais doit leur passer un savon à l’occasion » — personnage qui est à la fois un passage obligé et un boulevard à clichés. Quand ce comique est mêlé — voire dissimule — le drame, alors le personnage devient carrément passionnant. Il apparaît comme un homme dont l’absence de naturel est un choix assumé de la part de Setbon et de Leroux : en effet Vanderwalk est un représentation permanente, a perdu lui-même le contact avec le naturel. Une seconde saison qui traiterait au fil de plusieurs épisodes du cas de son fils pourrait ainsi se révéler diablement passionnante et définitivement installer cette figure iconoclaste.
La grande idée de Philippe Setbon pour le Commissaire cette saison, aura sans conteste été le rapprochement opéré avec Ilda Floss. Dans ce rôle, Farida Rahouadj est parfaite de simplicité, ce qui définit très bien ce personnage qui va toujours droit au but. Le duo romantique formé avec Vanderwalk est original, drôle et porteur de promesses intéressantes en terme de dynamique. Surtout, il évite l’isolement à Floss, qui est toujours la principale chausse-trappe pour ce type de personnages.
Au moment de conclure, que dire finalement de « Greco » ? Probablement que, comme beaucoup de fictions françaises ces derniers temps, la série est pleine de bonne volonté — pire : pleine de potentiel. Mais celui-ci tombe trop souvent à plat par la faute d’un gros manque de confiance dans l’intelligence de ceux qui regardent. Est-il celui de l’auteur ou bien d’un diffuseur effrayé à l’idée de faire fuir les habitués d’une case de programme réservée au genre policier ? On soupçonne qu’il s’agisse de la seconde solution. Et on l’espère. Car, dès lors, une seconde saison tournée avec plus de liberté artistique pourrait conduire à révéler les qualités que possède la série, qui ne sont pas des qualités fréquentes chez ses consœurs hexagonales.
Reste déjà à faire de cette seconde saison potentielle une réalité avérée. France 2 en a choisi autrement : l’annonce officielle de l’annulation de « Greco » étant intervenue quelques semaines après sa diffusion en juillet 2007.
Les six épisodes qui composent la première saison de « Greco » sont disponibles dans un double DVD édité par France 2.
Au passage, celui qui a eu l’idée de la tag-line « Un justicier pour qui la mort n’a pas de secret » sur la jaquette aurait franchement pu s’abstenir !
Post Scriptum
France 2 - PM Holding
Saison 1 - 6 épisodes
Première diffusion : mai 2007
Créé, écrit et réalisé par Philippe Setbon
Avec Philippe Bas, Audrey Lunatti, Maxime Leroux, Farida Rahouadj, Matin Gabin.
Dernière mise à jour
le 28 avril 2010 à 16h44
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
- DOCTOR WHO — An Unearthly Child (épisodes 1 à 4, 1963)
Dans la même rubrique
Notes
[1] Les six épisodes de la saison : « Contact », « La deuxième silhouette », « Corps et âme », « Fille de quelqu’un », « Mon Assassin » et « Petite Julie » sont tous écris et réalisés par Philippe Setbon.