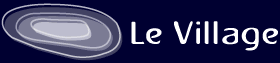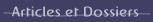La télé française et la malédiction des Feel Good
Par Nicolas Robert.
L’info était donnée il y a une petite dizaine de jours. Ou plutôt elle a été confirmée par Laurent Storch : TF1 planche activement sur un projet de feuilleton quotidien à opposer au bulldozer « Plus belle la vie » de France 3. “Ça n’aura pas grand-chose à voir avec PBLV”, a expliqué le président de TF1 Productions. “On est en train de produire les pilotes. Ce sera plutôt sociétal et sur le ton de la comédie. Avec des têtes connues”.
Tremble ami, téléspectateur (oui, je sais : une première chronique dans le sacro-saint Quinzo et je te tutoie déjà. C’est culotté, j’en conviens), parce qu’en gros, si le monsieur t’avait dit dans la même phrase qu’il aimait les poids chiches mais qu’il préférait l’avion (avec ou sans Philippe Risoli), ce serait rigoureusement la même chose.
Eh oui : parler de “projet sociétal sur le ton de la comédie”, ça ne veut rien dire. Enfin, si : ça veut dire qu’on va sans doute tenter de décliner le ton des téléfilms du lundi soir de la première chaîne en feuilleton format 26 minutes.
Je le redis : tremble ami, téléspectateur.
Parce que, si on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise (et j’adore avoir tort quand on me surprend en bien), cette courte annonce a tout pour ne pas faire rigoler. Et nous rappeler qu’en France et surtout à la télé, on a un gros problème avec la comédie.
A l’heure où « Intouchables » cartonne au ciné, le genre s’exprime de deux façons contradictoires sur le petit écran (hormis une exception notable : « Fais Pas Ci Fais Pas Ça », sur France 2). D’un côté, les créations courtes, souvent sous forme de sketches (Avec « Scènes de Ménages » et surtout la très efficace et très exposée « Bref »), de l’autre, les unitaires de 90 minutes où un ange-gardien, des cuistots et une équipe qui gère un camping. Et là, on est dans la comédie qui n’en est pas. Un truc passe-partout où l’on vise au ras du sol.
L’objectif : divertir sans provoquer, sans prendre à bras le corps un sujet parfois délicat mais qui permet de mettre en valeur des personnages qui ressemblent au téléspectateur. On parle de ce qui est “sociétal” mais on se sert de certains thèmes comme d’un alibi pour pondre une histoire bouclée, assez vaine et sans que jamais la conclusion n’évolue vraiment.
Tout terminera toujours très bien, sur une franche rigolade rappelant un peu « Navarro » et sa fille Yolande avec le fauteuil. C’est la joie des Feel Good, ces personnages dont TF1 raffole et dont il est question dans un excellent panorama de la comédie en France, dressé il y a quelques jours par Télérama.
Comprenons-nous bien : je sais que les comédies britanniques ou américaines fonctionnent sur des schémas qui font que, globalement, les personnages restent plus ou moins les mêmes épisode après épisode. Mais leurs tempéraments s’appuient toujours sur un dilemme personnel avec lequel ils composent semaine après semaine. C’est ce qui fait qu’ils nous ressemblent. C’est ce qui fait qu’on les apprécie. Et c’est ce qui fait qu’ils nous émeuvent.
Et tout le problème français est là : Les Feel Good, ça n’émeut jamais personne. Sur 90 minutes, ce constat est pénible à faire mais sur 26 minutes... il risque d’être particulièrement violent et peut provoquer un bon gros “accident industriel”, comme on disait sur cette même chaîne à une époque. Donc si on pouvait éviter de nous proposer ces pantins tous les soirs avant le JT, ce serait très gentil... parce qu’il y a de fortes chances qu’on continue de regarder une autre chaîne à cette heure-là.
Variation sur le statut du réalisateur
Par Dominique Montay.
On en parle très souvent quand on se plaint de l’omnipotence des réalisateurs sur les œuvres télévisuelles, alors que nos voisins ont très vite compris que pour pérenniser une série, le pouvoir doit être donné à une personne étant capable de travailler sur son intégralité : un scénariste. Le pourquoi de cette situation est historique, traditionnel. Hormis quelques cas particuliers au cinéma (Michel Audiard est le seul exemple qui me vient en tête, et encore, lui aussi était réalisateur), les scénaristes ne sont jamais cités.
Quand aux États-Unis on dit surtout “a film directed by” (un film réalisé par), en France on dit “un film de”. La première formulation appelle une question (“et qui a écrit ?”), la seconde, clôt la conversation, et érige le réalisateur au statut d’unique auteur du film. Peu importe si un autre gugusse l’a écrit. Cette starisation (elle peut-être méritée, mais ne devrait pas l’être au point d’étouffer l’autre) repousse le statut du scénariste au niveau du directeur de la photo, du monteur. En gros, un technicien supérieur, un rouage majeur du film, mais invisible.
Cette mise en avant du réalisateur lui confère un pouvoir incroyable. Droit de vie ou de mort sur les dialogues, possibilité de réécrire à l’infini… une attitude qui peut tenir la route au cinéma, bien sûr, mais qui revient à se tirer une balle dans le pied en série télé si le producteur ne prend pas un rôle interventionniste pour garder l’unité du récit. De plus, on crée ainsi une nécessité pour certains scénaristes de devenir réalisateurs pour que leurs mots soient respectés à l’écran. Mais rares sont ceux qui sont capables de faire les deux métiers, tant ils sont différents et réclament des modes de fonctionnements quasi opposés (réflexion et calcul pour le scénariste, réactivité pour le réalisateur, entre autres).
Pourquoi est-ce que je RE-parle de ça ? A cause de Steven Spielberg. Toute histoire de talent et de qualité de travail mise de côté, juste en terme de popularité, si vous allez dans la rue et que vous demandez à 100 personnes de citer le nom d’un réalisateur de cinéma, vous avez de grandes chances d’avoir une pelletée de « Spielberg ». Je pourrais sortir et vérifier ma théorie, mais je ne veux pas (il fait froid).

- Steven Spielberg & George Lucas
- (Super Papy et Papy Gâteux)
Et qu’à dit de Spielberg de si incroyable pour motiver (et m’aider à trouver un sujet) un billet du quinzo ? Il a parlé du « Royaume du Crâne de Cristal ». Splendide foirage cinématographique à deux doigts de ruiner l’image d’une idole dont la paternité est définie comme suit : réalisé par Spielberg, écrit par un patron de ranch, George Lucas. Spielberg a dit « je prend la responsabilité de la scène du réfrigérateur, mais pour les êtres interdimentionnels, l’idée est de Lucas, c’est dans son scénario, que j’ai respecté. Je n’y croyais pas, mais c’est George qui écrit ».
Respect du scénario. Venant de la part de celui qui exprime certainement le mieux le métier de réalisateur au monde.
La conscience que s’il maîtrise son art, il se doit de faire confiance à ceux qui maîtrisent l’autre. Est-ce que pour autant son égo s’en trouve diminué, son aura moins puissante ? Est-ce qu’on pense à Steven Spielberg comme un incompétent puisqu’il n’écrit pas tous ses films ? Les américains sont tellement décomplexés vis-à-vis de ça, ils donnent tellement de valeur au scénario (et donc au scénariste) que ça fait envie.
Il n’y a qu’à voir le fameux documentaire interdit « Fucking Kassovitz » (mis en ligne sur Dailymotion), qui parle des soucis rencontrés sur le film « Babylon AD » pour échafauder des théories sur les raisons de ce désastre : et si Vin Diesel (un type loin d’être un bourrin décérébré) était juste entré en conflit avec Mathieu Kassovitz juste parce que le scénario n’était pas bon ? Un Kassovitz qui avoue lui-même ne pas aimer s’asseoir pour écrire une histoire, mais l’écrire en la réalisant. Une approche tellement éloignée de l’américaine, tellement incongrue pour Diesel qu’il se retrouve en conflit (très bêtement, il faut l’avouer) avec son réal ?
Nous ne donnons aucune confiance au scénariste, aucun poids, et, encore plus grave, une faible importance au scénario. C’est pourtant la base de tout travail audiovisuel, et encore plus télévisuel.
Bon, maintenant, je vous l’accorde, à faire confiance à un scénariste, on est pas obligé d’écouter les divagations d’un patron de ranch.
Séries : Arte réduit la voilure
Par Sullivan Le Postec.
En 2011, Arte a diffusé trois séries originales françaises différentes : « Les Invincibles » saison 2, « Fortunes » et « Xanadu ». Malgré leurs imperfections, elles avaient le mérite de s’avancer sur des sentiers différents. Mais la chaîne franco-allemande lève déjà le pied.
François Sauvagnargues, directeur de la fiction d’Arte de 2003 à cet été, s’est beaucoup battu en interne pour imposer des séries sur l’antenne de la chaîne. De l’extérieur, on a une vision assez monolithique de l’organisation d’une chaîne de télévision. En réalité, elles sont bien souvent divisées en deux camps que se mènent une quasi guerre larvé : les départements de conception des programmes, et ceux de la programmation. Cette schizophrénie est finalement à l’avantage des programmateurs, qui disposent de l’arme absolue : ne jamais mettre dans la grille le programme qu’ils n’aiment pas. Or le niveau de compétence moyenne d’un programmateur français va de inexistant à très mauvais.
L’air du temps aidant, Sauvagnargues a fini par l’emporter, la production de séries Arte a été lancé, avec l’ambition d’en proposer trois par an. L’un des gros problèmes de la fiction française étant son absence totale de séries ne niche dans lesquelles pourraient se concevoir le mainstream de demain, cette initiative d’Arte était salutaire, et on ne pouvait que se féliciter de la voir atteindre cet objectif quantitatif en 2012.
Mais 2011 a marqué de gros changements dans la direction d’Arte, au moment où elle fêtait ses vingt ans. On apprenait en juin que François Sauvagnargues était poussé vers la sortie. C’est désormais Judith Louis qui est à la barre de la fiction, sous l’autorité du directeur éditorial d’Arte France, ex-directeur de la fiction de France Télévisions, Vincent Meslet.
Arte France communique désormais sur sa ligne éditoriale. Sur les séries, la voilure est réduite : on redescend à seulement deux séries originales par an. Et encore, cet objectif ne sera pas atteint avant un moment puisque la chaîne n’est pas en capacité de signer de nouveaux projets de séries avant 2013.
En 2012 et 2013, Arte ne devrait donc programmer qu’une seule série française par an. Ce sera « Ministères / Ainsi soient-ils » en 2012 (huit épisodes), puis en 2013 « L’Odyssée », dont le tournage des 12 épisodes commencera début 2012 au Portugal pour se terminer vers le début de l’été.
Dernière mise à jour
le 13 décembre 2011 à 03h39
Articles par Dominique Montay
Articles par Nicolas Robert
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français