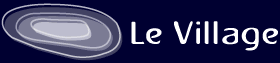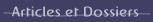10 bonnes raisons de regarder « Ashes to Ashes »
par Dominique Montay
C’est la grève aux USA. Plus de séries, plus de films. Quoi de mieux que nos chers amis de la BBC pour nous abreuver de fictions de qualités en attendant. « Ashes to Ashes », spin-off de « Life on Mars », s’annonce comme un hit.
« Ashes to Ashes » reprend là où s’était arrêté « Life on Mars », sur une note mi-sombre, mi-joyeuse. Comment les auteurs de la première vont donner corps à la seconde ? Volonté artistique de prolonger l’étude sociale de la pop-culture britannique ? Désir de surfer sur un succès pour en enclencher un autre ? Mercantilisme ? Quoi qu’il arrive, « Ashes to Ashes » est l’une des série les plus attendues de l’année...
Raison n°1 :
Parce qu’on est curieux
Comment vont-ils rebondir après ce qui s’est passé dans « Life on Mars » ? La solution apportée au terme de cette série est aussi rationnelle que déprimante, dans un certain aspect. Ce monde dans lequel Sam échoue est une régurgitation de tout ce qu’il a assimilé dans sa vie d’enfant. Rapport aux parents, aux anciens collègues, à cet univers de policier directement inspiré de ce qu’il regardait à la télévision à l’époque.
Dans « Ashes to Ashes », point de Sam Tyler, c’est Alex Drake qui se retrouve dans le monde de Sam, mais 8 ans plus tard, en 1981. Le tout est justifié par le fait qu’Alex, avant de tomber dans le coma, étudiait le cas psychologique de Sam Tyler. Plus jeune, Alex va inévitablement rencontrer des figures du passé, personnelles ou publiques. Redites, routine, sensation de déjà-vu, manque de mystère sur les raisons de la présence d’Alex Drake en 81, contrairement à « Life on Mars », où le mystère était part prenante du récit... beaucoup de pièges à éviter pour les auteurs.
Raison n°2 :
Parce que ça fait plaisir
C’est toujours un bonheur de retrouver des personnages qu’on aime. Qu’il s’agisse de Gene Hunt ou de ses deux bras cassés Ray Carling et Chris Skelton. Manquera à l’appel Annie Cartwright - sûrement partie avec Sam Tyler -, remplacée par Sharon Granger (Monserrat Lombard), nouvelle recrue féminine de la bande. D’après Ashley Pharoah, un grand secret sera révélé sur Hunt. Si Carling ne semble pas avoir beaucoup changé, Skelton serait devenu un génie de la technologie. Et puis, un espoir subsiste dans le coin de la tête : et si Sam Tyler réaparaissait dans la série. Si oui, sous quelle forme ? Guide d’Alex dans sa quête ? Apparition issue de l’imaginaire de la jeune femme ?
Raison n°3 :
Parce que parfois, les spin-off, ça marche
« Angel ». « Frasier ». « Star Trek [mettre terme ici] ». « CSI [mettre ville ici] » (enfin là, le succès est surtout financier...). « Law and Order [mettre terme policier ici] ». A chaque fois, ces séries étaient soit issues d’un univers fort (« Angel », « Star Trek ») avec un gros potentiel d’histoires à y raconter, soit elles capitalisent une formule qui a fait ses preuves et dont les histoires proviennent de faits divers (« CSI », « Law and Order »), soit elles ont réussi le tour de force de changer de style et d’aborder un type d’humour différent (« Frasier »). Dans quelle créneau se place « Ashes to Ashes » ? L’univers est collé aux années 80, mais ne semble pas d’une richesse sans fin. La formule, axée sur l’anachronisme, risque de lasser (certains épisodes de « Life on Mars » étaient parfois répétitifs). Quand au style, nul ne sait si « Ashes to Ashes » sera plus léger que « Life on Mars » ou au contraire plus mélo. Les bandes-annonces semblent humoristiques, mais le point de départ de la série (accident de voiture d’Alex et de sa fille), ne semble pas donner dans le comique.
Raison n°4 :
Parce que... Keeley Hawes est magnifique
En plus d’être une excellente actrice, toujours dans le ton, Keeley est aussi un bonheur à regarder. A l’heure où l’idéal féminin se place sous la barre des 45 kilos et où l’authenticité de certaines actrices laisse à désirer, Keeley se place comme une alternative issue du réel. Ronde mais pas trop, le visage expressif et parfaitement dessiné, elle touche tout de suite droit au coeur. Talentueuse, sous employée au cinéma, elle trouve à la télévision des rôles à sa hauteur, qu’il s’agisse de Zoe Reynolds dans les trois meilleures saisons de « Spooks », ou cette fois ci Alex Drake dans « Ashes to Ashes ». Seul bémol, la coiffure que va arborer Keeley est... comment dire... surprenante. Une sorte de permanente tout droit sorti de Dynasty... pas grave, elle est belle quand même.
Raison n°5 :
Parce que la BBC fait de bonnes séries
Dans les grandes lignes, c’est assez vrai. « Spooks », « Life on Mars », « Doctor Who », « State of Play », « Jekyll »... le nombre de fictions de qualité issues de cette chaîne (publique !) se comptent sur bien plus que les doigts des deux mains. Une vraie politique de séries télés exportables, maîtrisées au niveau de l’écriture et de la réalisation, le tout avec des moyens qui s’apparente à ceux des français. Sauf que là-bas, on fait confiance aux auteurs...
Raison n°6 :
Parce que la BBC, on peut la regarder partout
En France, sur le satellite. Aux USA sur BBC America (bon plan pour les collègues de chez PerdUSA, ça reste en direct aux Etats-Unis...) [1]. La grève sera-t-elle une aubaine pour les séries européennes ou un coup d’épée dans l’eau ? Les networks commencent à diffuser des séries issues du câble (« Dexter » par exemple, avec Jennifer Carpenter post synchronisée en train de dire "flump" au lieu d’un autre terme interdit - info à vérifier, cependant), pourquoi pas des séries anglaises. En regardant « Ashes to Ashes » avant qu’elle soit récupérée par une grande chaîne ricaine, vous pourrez dire "moi je l’ai vu avant".
Raison n°7 :
Parce que les années 80
Coiffures-choucroute, claviers bontempi, house musique, ABBA... De la même façon que « Life on Mars » traitait et habillait sa série des années 70, il en sera de même avec son spin-off. Le statut de la femme sera encore un point central, tout comme, certainement, la fin de la libération sexuelle, l’émergeance de nouvelles maladies, démarrages de la société mercantile, années Thatcher, autant d’évènements culturels et pop-culturels à aborder pour cette série.
Raison n°8 :
Parce que c’est la grève des scénaristes aux USA
Et à moins que vous habitiez dans une grotte et que vous ne regardiez pas de séries télés, ni de films, vous êtes au courant de cette grève qui oppose des scénaristes qui veulent gagner de l’argent en fonction de ce que rapporte leurs oeuvres (bande de fous insensibles !) et des patrons de majors qui ont déjà plus perdus d’argent en quelques mois de conflit que s’ils avaient signés des accords (tenez bon, les gars, le peuple est avec vous... comment ça j’ai inversé mes parenthèses ?).
Raison n°9 :
Parce que Keeley Hawes est belle
Je l’ai déjà dit ? Ah bon.
Raison n°10 :
Parce qu’on vous le dit et puis c’est tout
Voilà. Bon visionnage.
Premiers pas réussis
par Jean-Michel Vacheron
Depuis quelques mois déjà, les chaînes de télé lancent de nouvelles séries françaises s’inspirant avec plus ou moins de réussite du savoir-faire américain afin de moderniser la fiction hexagonale. Parmi toutes ces tentatives plus ou moins réussies, quelques perles ou bonnes surprises arrivent à faire surface.
« Les bleus : premiers pas dans la police » [2], diffusée récemment sur M6, est de celles là.

- Les Bleus, premiers pas dans la police
L’une des raisons principales qui m’ont donné envie de regarder la série est que l’un de ses créateurs et scénaristes n’est autre que Stéphane Giusti qui a réalisé l’excellent téléfilm « L’homme que j’aime » (qui a battu des records d’audience sur Arte et qui a remporté de nombreux prix dans des festivals) ainsi que la comédie « Pourquoi pas moi ? » avec Bruno Putzulu, Elli Medeiros et… Johnny Halliday ! L’une des particularités de cet auteur (qui se retrouve dans « Les bleus ») est de mêler habilement humour et gravité à la manière de la série trop méconnue (mais pourtant excellente) « Rescue Me » (diffusé en France sur Jimmy sous le nom un poil racoleur : « Rescue me, les héros du 11 septembre »).
Au premier abord, on pourrait croire que « Les bleus » est une enième série policière sans saveur mais, ici, on est à des années-lumière des sempiternels « Navarro », « Julie Lescaut » et autres « Femmes de Loi ».
Présentée comme une comédie, « Les Bleus » oscille plutôt entre scènes comiques, légères, loufoques, dramatiques ou carrément tragiques. A l’image d’une série américaine façon « Urgences » ou « The Practice », on y trouve des histoires bouclées en un seul épisode alors que plusieurs de ses sous-intrigues sont feuilletonnantes (l’épisode 6 se termine d’ailleurs par un cliffhanger impressionnant que « 24 » ou « Prison Break » n’auraient pas renié).
Pour l’histoire, « Les bleus » nous raconte (comme son nom l’indique) les premiers pas dans la police de jeunes recrues. Ceux-ci étant inexpérimentés, ils font souvent des gaffes énormes ou même des erreurs tragiques par idéologie ou carriérisme et c’est ça qui fait l’un des intérêts de la série (en plus de ses dialogues qui sonnent juste). Ils sont également tous très attachants et on s’intéresse à leur histoire car ils ont chacun des motivations ou des raisons particulières qui les a fait rentrer dans la police (Laura cherche à y rencontrer son père qui a de lourds secrets, Beloumi envisage une carrière politique, Kevin a été muté par erreur, Nadia recherche la sécurité de l’emploi et Alex veut résoudre une enquête personnelle). Tous ces élements font qu’ils sont loin d’être aussi lisses que tous les clones de Julie Lescaut qui polluent les séries télé françaises depuis maintenant plus de 20 ans.
« Les bleus » a aussi ses petits défauts dûs à sa jeunesse ou à son manque de moyen (le même morceau de Massive Attack revient systématiquement à chaque épisode par exemple) mais, si on fait facilement l’impasse sur ceux-ci, on prend beaucoup de plaisir à la regarder car c’est aussi une série qui ne se prend pas du tout au sérieux.
Quoiqu’il en soit, Stéphane Giusti, Alain Robillard et Alain Tasma (l’un des autres co-créateurs des bleus, spécialiste du genre policier) ont bien pris en compte le fait que, pour faire une bonne série, il ne suffisait pas de copier les américains en reprenant leurs concepts et en ne travaillant que sur la forme. En effet, le plus important, c’est le fond et ça, ils l’ont bien compris !
Malgré les audiences mi-figues, mi-raisins de la saison 1, plusieurs raisons ont poussé M6 a lancé la production d’une saison 2 :
des critiques presses de plus en plus élogieuses au fur et à mesure de la diffusion des épisodes
une audience sur les 15-35 ans qui augmentait petit à petit jusqu’au dernier épisode grâce au bouche-à-oreille
l’obtention de plusieurs prix dans des festivals (Meilleure série au Festival de la fiction de Luchon 2006 et Meilleure série de prime-time au Festival de la fiction TV de la Rochelle 2007)
Pour ma part, alimenté depuis des années par les séries américaines, c’est la première fois que je suis aussi enthousiaste à propos d’une série française moderne (qui plus est, policière). J’espère qu’elle continuera longtemps avec succès et qu’elle deviendra un exemple à suivre pour les autres productions françaises.
Post-scriptum :
La saison 1 est disponible depuis décembre en DVD. Il est aussi conseillé de guetter une éventuelle rediffusion de celle-ci sur M6 ou une autre chaîne du groupe.
Les Lascars
par Amrith
A quelques mois seulement d’une consécration sur grand-écran prévue pour la fin 2008, la série animée « Les Lascars » s’est récemment offert un second raid télévisé par le biais de trente épisodes supplémentaires. Officiellement labellisée Saison 2, cette nouvelle flopée de mini-sketches diffusée dès Septembre 2007 sur Canal + intervient pourtant à neuf années d’intervalle de la précédente, laquelle avait connu le succès en s’exportant dans toute l’Europe et jusqu’aux Etats-Unis.

- Les Lascars
La formule reste identique, une short com de chez short – chaque segment avoisine la minute – située dans le microcosme de la banlieue et de la street way of life si chère au mouvement hip-hop. Embrouilles diverses, business qui tombent à l’eau, drague bancale, gangsters du dimanche, frime sans limite et substances psychotropes, le cocktail ne varie pas mais la qualité d’écriture de la paire Alexis/Boris Dolivet a encore grimpé d’un cran. Attendrie, la description des quartiers via le prisme de ces savoureuses giclées d’humour enjambe sans heurts la démagogie en vigueur de chaque côté du discours politicien. A mille lieux des vociférations sécuritaires ou des émois compassionnels, la réalité extrapolée de la série présente des lascars nuancés, aussi récalcitrants à l’étiquette de la délinquance armée qu’à celle de la chorale de scouts. Social par nature mais non-revendicatif, le dessin animé se positionne avant tout comme un divertissement efficace, du stretching – ou plutôt du breakdance – pour zygomatiques qui se grandit d’éviter au possible tout aphorisme ronflant. Bien sûr, en tant que produit de niche, la série satisfait en priorité un public de jeunes adultes réceptifs aux conventions usuelles de l’arpenteur de cages d’escaliers, et possédant une connaissance au moins fragmentaire des courants musicaux apparus dans le même sillage. Sur un plan strictement culturel, le programme baigne en effet dans un monde référentiel assez fourni, quoique jamais opaque pour l’extérieur.
Hommage auto-parodique à la (sub)culture hip-hop, « Les Lascars » bénéficie d’une esthétique graphique et musicale attachante, relativement inédite à la télévision française. La réalisation intentionnellement poisseuse et de facto réussie de David et Laurent Nicolas, tous deux formés aux Gobelins [3], retranscrit à la perfection le comportement et la gestuelle typique des B.Boys flambeurs de la capitale. Les décors post-urbains quant à eux sont riches en graff’ conçus spécifiquement pour l’occasion, tandis que la bande-son signée IZM exalte la religion du sampler. Autre atout majeur de la série, ses personnages sweat-capuches aux tronches insolites, au langage garanti sans polissage, dont les voix enfumées sont régulièrement campées par une catégorie d’acteurs à part, ceux de l’histoire du rap français : les praticiens les plus "mainstream" – Disiz La Peste, Diam’s, le groupe Sniper – se joignent aux figures de l’underground parisien – Abuz, Daddy Lord C., D’ De Kabal – pour un doublage qui ne peut résolument pas laisser de marbre les familiers du beat hexagonal, d’où qu’ils soient ; a contrario, les réfractaires au genre, les mines interrogatives à l’énoncé des mots "zetla", "bouillave" ou "boloss" ainsi que les cinéphiles plus rangés préfèreront peut-être la présence occasionnelle au casting de comédiens expérimentés tels que Vincent Cassel ou Féodor Atkine. Davantage qu’une succession fendarde de tranches de vies ghetto à destination du ghetto, « Les Lascars » vise plus large et pourrait bien en complément revêtir une fonction culturelle indispensable : celle de témoin animé des années fastes du rap en France, memento d’une ère aujourd’hui réduite à l’état de vestiges par le conformisme ambiant et la récupération médiatico-financière.
Aux dernières nouvelles, l’équipe aux manettes fomenterait la sortie prochaine d’un pack DVD comprenant l’intégralité des 64 épisodes de la série ainsi qu’un imposant making-of. Pour les impatients, un premier DVD regroupant les sketches de la Saison 1 est disponible depuis 2000, et six épisodes tirés de la Saison 2 sont actuellement consultables en streaming sur le site du dessin animé. Va falloir bédave un p’tit blunt avant d’checker ça.
French Police Blues
par Sullivan Le Postec
Mini-série de deux épisodes de 100 mn, « À Cran » [4]
est une plongée sombre dans le quotidien d’une police écartelée entre ses idéaux et la réalité. Elle vient contredire le sentiment persistant selon laquelle la fiction policière française, débitée au kilomètre par les différentes chaînes, ne proposerait jamais rien d’intéressant.
En pleine journée, un flic se suicide par balle dans les toilettes du commissariat où il travaille tous les jours. La hiérarchie policière décide d’y envoyer le psychologue Hervé Guillermé (Didier Besaze, aussi excellent que dans « Reporters ») pour tenter de panser les plaies psychologiques des collègues de la victime. Sur place, cependant, presque personne ne se montre accueillant ou même bienveillant. Car s’il est vital de libérer la parole et de mettre au jour les blessures secrètes des hommes et femmes chargés de représenter la loi, cela pourrait aussi se révéler explosif...

- A Cran
Les entretiens de Guillermé exposent en premier lieu les parcours incertains de deux flics aux antipodes l’un de l’autre. Bob (Daniel Russo) était le collègue du suicidé. C’est un personnage plein de bonhomie, un peu balourd mais avec un grand coeur. Il veut le meilleur pour sa femme et son fils et c’est comme cela que, de fil en aiguille, il en est venu à la petite corruption. Lui et son partenaire se partageaient les enveloppes de billets. Mais son suicide menace de mettre à jour ces magouilles.
Donadieu (Jérôme Anger) est la droiture incarnée, mais c’est aussi un homme singulièrement dénué d’empathie, insensible aux difficultés des gens qu’il croise dans l’exercice de son métier autant qu’à celles de ses collègues. Il tranche tous les dilemmes dans le vif, plaidant pour une vision du monde en noir et blanc.
Au fil de la première mini-série, ces deux hommes suivent des voies opposées : Bob prend conscience de ses èrements et avance vers la rédemption, même si ce retour à une certaine réalité est cruel. Donnadieu, le syndicaliste jusqu’au-boutiste, glisse vers le fascisme en devenant tout à la fois flic, juge et bourreau — dans son esprit il s’agit de sauver une collègue de sa faiblesse.
Car « À Cran » est aussi l’histoire de deux personnages féminins. Edith (Charley Fouquet) semble chercher un père alors qu’elle pourrait se permettre de marcher de ses propres pas : elle est celle qui prend les décisions les plus intègres. Nadia (Julie Bataille), beurette dans la police, sœur d’un islamiste emprisonné, et tombée amoureuse d’un dealer navigue à vue pour tenter de trouver l’équilibre dans un monde violent et injuste.
A bien des égards, les deux femmes, qui tentent de trouver leur place dans un univers trop masculin, sont aussi les seuls éléments solides de ce commissariat en perdition.
Le succès de la première mini-série a permis la production d’une suite qui prend le parti de reprendre deux ans plus tard l’étude de ces personnages et de leur trajectoire. Si le scénario en est moins achevé (les coïncidences permettant le développement de la narration sont trop nombreuses), la richesse psychologique reste bien supérieure aux productions françaises habituelles. Privés du personnage du psy, les scénaristes créent un jeu de miroir déformant avec la première partie : Bob se débat au sein d’une nouvelle affaire – mais cette fois-ci il est innocent. Edith s’est trouvé un nouveau mentor qui cette fois ne la rejette pas – mais ses sentiments pour lui sont tout aussi illusoires que ceux qu’elle éprouvait pour Guillermé. Enfin, Nadia revit son drame par procuration lorsqu’elle traque le dealer dont est amoureuse la propre fille de Donadieu, flic « modèle » devenu Délégué Général de son syndicat. Deux ans après, cèdera-t-elle aux sirènes de la vengeance ?
Étant donné le lourd passé porté par les personnages, il n’était pas facile de permettre au public de s’attacher la seconde histoire. Un gimmick déjà présent dans la première « saison » se révèle fort utile : l’insertion de courts flash-backs qui renvoient vers des événements passés. Et les remettent en perspective : souvent, les motivations des personnages ne sont pas celles qu’on avait initialement imaginées. Si les personnages nagent en eaux troubles et franchissent à plusieurs reprises les limites de la moralité, celles-ci existent bel et bien, et la transgression n’est pas sans conséquences. Le travail des scénaristes d’« À Cran » propose donc une réflexion sur le sujet plutôt que de se contenter d’imposer un marécage idéologique branché mais douteux.
Les deux mini-séries sont rediffusées trois à quatre fois par an sur diverses chaînes du câble et du satellite. En fouillant les bacs, on pourra aussi retrouver la première, éditée à l’époque en DVD. Le relatif échec de la seconde mini-série à l’échelle de l’audimat ne lui a pas permis d’avoir ce privilège.
Dernière mise à jour
le 29 décembre 2009 à 19h13
Articles par Amrith
Articles par Dominique Montay
Articles par Jean-Michel Vacheron
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
- DOCTOR WHO — An Unearthly Child (épisodes 1 à 4, 1963)
Dans la même rubrique
Notes
[1] Note de Sullivan : leur donne pas des idées malheureux, ils vont dévaliser toutes nos marchandises ! Ce sont des addicts en état de manque, je te rappelle...
[2] Cipango - M6
Pilote + Saison 1 : 13 épisodes
Première diffusion : Septembre 2007
Une série créée par Stéphane Giusti, Alain Tasma et Alain Robillard.
Avec : Mhamed Arezki, Nicolas Gob, Raphaël Lenglet, Gabrièle Valensi, Elodie Yung.
[3] Célèbre école parisienne dédiée aux métiers de l’image dans leur ensemble, mais surtout réputée pour la qualité d’enseignement de son département d’animation, fondé en 1975. De renommée internationale, il a notamment formé des animateurs qui rejoignirent plus tard Walt Disney, Hanna-Barbera ou Pixar.
[4] A Cran / A Cran 2 ans après
France 2, 2002 et 2004
Scénaristes : Marie Montarnal & Gérard Carré
Réalisateur : Alain Tasma
2 mini-séries de 2x100 mn.