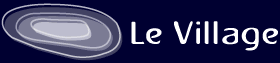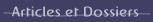A la fin des années 1990, alors que la fiction télévisée française vient de subir quinze ans d’une traversée du désert faite de héros-citoyens insipides et de produits bâclés façon AB Productions, une prise de conscience — avant tout motivée par des réalités économiques, d’ailleurs — s’opère. Un renouveau qualitatif est nécessaire. Il faut reconstruire ce que la faute des uns et la négligence des autres a laissé disparaître.
On peut fixer l’année zéro de cette nouvelle page de l’histoire de la fiction télévisée française à la création de la case de fictions de 52 minutes le vendredi soir sur France 2, la fameuse ’’Soirée de/deux polars’’. C’était il y a pratiquement dix ans. Dix années pendant lesquelles la fiction française a subit de nombreuses évolutions, multiplié les tentatives et les approches. Le 52 minutes s’est multiplié, à mesure que l’idée faisait son chemin que c’était, très paradoxalement pour un esprit français, dans la sérialité et l’industrialisation que la fiction télé pouvait innover et le créatif retrouver sa juste place. Même si la fiction sociétale et le policier restaient deux incontournables, des tentatives régulières d’ouverture à de nouveaux genres apparaissaient : les sitcoms de Canal, le « Clara Sheller » de France 2, un téléfilm comme « Dans la tête du tueur » sur TF1, et les séries noires récentes de Canal, « Engrenages » et « Mafiosa »...
Mais le constat restait cruel : ces dix années sont passées sans que la fiction française ne puisse livrer d’oeuvre emblématique qui puisse incarner ce renouveau.
Dans le fond, cette volonté de (re)construire une fiction française diversifiée et ambitieuse se heurtait à une problématique simple : sur quel modèle bâtir ce renouveau ? Quelle référence suivre ? Il existait deux chemins différents.
Un patrimoine ignoré
Le premier, dont on a parfois le sentiment qu’il n’est venu à l’esprit de personne, aurait été de retourner aux origines, et de rebâtir à partir des grandes oeuvres de l’âge d’or de la fiction télé française. Il aurait été possible de se pencher sur ces productions dont chacun connaît les titres et les univers même si, comme l’auteur de ces lignes, ils sont nés après leur diffusion et n’en ont vu au mieux que quelques images. « Belphegor » et consorts font partie de notre inconscient collectif national. Il est d’ailleurs particulièrement frappant de constater à quel point c’est le cas, tandis qu’il ne reste d’ores et déjà pratiquement plus rien de « L’Instit’ » ou de « Navarro », séries pourtant emblématiques des quinze années maudites. Ces collections à héros récurrents ont été pensées pour ne pas provoquer le zapping, et pour que des rediffusions d’épisodes se mêlent imperceptiblement aux inédits et qu’ainsi elles continuent sans fin. La conséquence logique, mais sûrement pas prévue, de ces univers lisses et insipides est qu’ils ne comportent rien qui puisse accrocher la mémoire.
Revenir aux fictions marquantes qui les ont précédées et s’en inspirer pour en produire des avatars contemporains, voire des remakes revisités, aurait pu livrer des oeuvres de qualité. Ce n’est pas une autre voie que suivent les anglais quand ils laissent un auteur aussi viscéralement moderne que Russel T. Davies mettre à jour avec brio un monument kitsch comme « Doctor Who », ou encore quand ils planchent sur une nouvelle version du « Prisonnier », sommet d’intelligence télévisuelle qui servit de fondation à tant d’autres oeuvres, en Angleterre comme aux États-Unis.
Pourquoi n’en a-t-il rien été ? A vrai dire, il est assez probable que ce soit parce que l’ère post-privatisation avait amené à la tête des chaînes de télévision françaises des industriels géniaux quand il s’agit de gérer leur société de la manière à faire s’envoler ses quotations boursières, mais dénués de la moindre culture télévisuelle. Et persuadés, en toute absence d’humilité, qu’ils allaient tout réinventer. C’est en partie ainsi, d’ailleurs, que s’explique la particularité française qui consiste à inventer des formats sans queue ni tête. Tel que ces collections de 90 minutes à 4 épisodes par an, OVNIs sur des marchés d’export où l’on achète du 52’ comptant au moins 50 épisodes, ou encore tel que les improbables séries AB des années 90, mélange délirant de soap-opera, de sitcom et de divertissement pour ados comme les américains en programment le samedi matin. La mission du Service Public face à ces dérives aurait du être d’offrir un prolongement moderne au patrimoine existant. Mais sous l’influence de directions calamiteuses appliquant les recettes du privées, il se lança bêtement dans la concurrence frontale avec une pincée de mieux disant culturel. Ce fut donc « L’instit’ » contre « Navarro » ou « Seconde B » contre « Hélène et les Garçons ».
Un empire difficile à dupliquer
La seconde voie créative pour la fiction française était sans doute d’autant plus « évidente » que c’était le succès des séries américaines qui avait largement provoqué le désir de renouveler l’offre de fiction hexagonale. Mais c’était aussi la voie la plus difficile. Car la série américaine est le fruit d’un processus ultra-industrialisé, à la puissance de feu incomparable, et aux budgets très lourds. Sans compter qu’elle fonctionne depuis un demi-siècle sur un rythme extrêmement élevée et qu’elle a formé des dizaines de scénaristes, réalisateurs et autres créatifs à s’adapter en quelques mois, voire en quelques semaines, aux nouvelles tendances.
A de très rares exceptions près, les productions françaises qui s’inspirent de manière trop littérale de la série américaine n’arrivent à rien de mieux qu’à produire des sous-produits. Au pire, des nanars inoffensifs comme le décalque M6 de « Alias », « Lea Parker ».
Cette voie n’est pas nécessairement condamnée à l’échec, mais elle impose une rigueur, une compréhension subtile de ce qui fait la qualité des productions américaines, mais aussi des françaises, pour pouvoir espérer livrer un résultat qui soit à la fois satisfaisant et cohérent. Force est de constater qu’elle n’a pour l’instant, malgré d’assez nombreuses tentatives, jamais conduit à la réussite.
Aucune des deux voies, par manque d’exploration ou à cause de la difficulté du défi, n’a donc pu aboutir à la création d’une série pleinement réussie, et cet absence a en retour amplifié les difficultés des créatifs en repoussant toujours la définition de la nouvelle fiction française.
C’est que « Reporters » peut accomplir aujourd’hui, en imposant sa formule qui lui est propre. A ce titre, il faut espérer qu’elle représente une charnière à la télévision française.
Une formule originale
« Reporters » n’est pas une série d’inspiration américaine. Certes, on pourra dire qu’elle en a retiré quelques éléments, comme le travail sur le rythme, la ’’chorale’’ de personnages, ou l’attachement aux détails qui pousse le spectateurs à croire totalement au monde fictif dans lequel il peut réellement s’immerger. Mais ceux-ci sont moins les caractéristiques de la série américaine que simplement celles de la bonne fiction télévisée. On les retrouve aussi dans les fictions anglaises, ou dans une réussite québécoise comme « Minuit, le soir ».
La fiction américaine, par ailleurs, ne s’est pas beaucoup plus intéressée aux journalistes que la notre, et quand elle l’a fait, c’était plus comme un background chargé de cliché qu’au travers d’une véritable analyse. Sans compter que l’histoire développée dans « Reporters » décode au plus près la réalité politique et médiatique de notre pays, comme ne pourra jamais le faire une oeuvre dont les bases reposent sur une fiction étrangère.
Surtout, « Reporters » se montre capable d’intégrer à une intrigue riche, ambitieuse, très politique — trois mots nouveaux pour la fiction française — les points forts avérés des 7ème et 8ème arts hexagonaux. C’est à dire un réalisme social fort et un haut niveau de définition et de richesse des personnages. Les six principaux, et quelques autres des récurrents, disposent d’une caractérisation complexe et subtile ; ils ne sont jamais monolithique, mais au contraire directement abordés par le biais de leurs paradoxes apparent, qui ne font que démontrer une réelle cohérence psychologique. La même chose peut être dite du monde dans lequel ils évoluent, un monde dur, un peu déboussolé, sans repères, et ou chacun se doit de trouver la définition de son propre espoir. « Reporters » est donc parvenue a tirer le meilleur parti des possibilités de son médium, en faisant un usage parfait des codes de la série télévisée, et à y intégrer le meilleur du cinéma français.
La formule est originale. Sa réussite est indubitable. Le frémissement de buzz très positif qui émerge en témoigne. « Reporters » constitue une référence parfaite à explorer pour construire d’autres séries abordant d’autres univers, d’autres personnages, d’autres styles, mais gardant le même niveau de qualité. Mais faire de « Reporters » la série emblème de la fiction française moderne dépend surtout... de nous ! Il s’agit en effet d’en parler, de faire savoir ce qu’on pense de sa qualité, d’analyser son contenu et sa construction. Que Canal+ soit au courant ne gâchera rien (Canal+, service consomateur, 62976 Arras Cedex 9). Que les ventes du coffret de la première saison en DVD soit excellentes non plus.
Bref, pour résumer en une formule : le buzz, c’est nous.
Dernière mise à jour
le 17 février 2011 à 00h40
« Reporters », une série référence
- « Reporters »
- CLAUDE CHELLI — “Reporters parle de l’emprise économique et politique qui limite le champ d’action des journalistes”
- ANALYSE - « Reporters », une nouvelle référence
- AISSATOU DIOP — “J’ai moi- même pris de l’assurance au fur et à mesure du tournage. Au début, j’ai vraiment débarqué comme Elsa !”
- ANNE COESENS — “J’ai été attirée par les contradictions et les faiblesses du personnage”
- SUZANNE FENN — “Sur le tournage, tout le monde était mis au défi”
- FORCES NUANCES - Les personnages de « Reporters »
- OLIVIER KOHN 1/2 — “L’info est fabriquée avant d’arriver dans la bouche du présentateur”
- OLIVIER KOHN 2/2 — “Cette tonalité désespérée mais combative est proche de ce que ressentent les journalistes”
- GILLES BANNIER — “Le travail avec les acteurs est la clé de voute de la fabrication d’un film”
- REPORTERS - Saison 1
- NOUVEAU DOSSIER « REPORTERS » : Tout sur la saison 2. Contenus exclusifs !
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
- DOCTOR WHO — An Unearthly Child (épisodes 1 à 4, 1963)
Dans la même rubrique
- POLÉMIQUE — Après « Inquisitio », France et fiction : le divorce
- DOCTOR WHO — ‘‘Let’s do it !’’ / ‘‘I can’t do it !’’ : anatomie d’une collaboration galloise
- FOCUS — La fiction télé française et la politique
- PRODUCTION — Les budgets trop lissés font-ils des séries lisses ?
- RÉGULATION — Et tranquillement, le CSA proposa de tuer la fiction française...